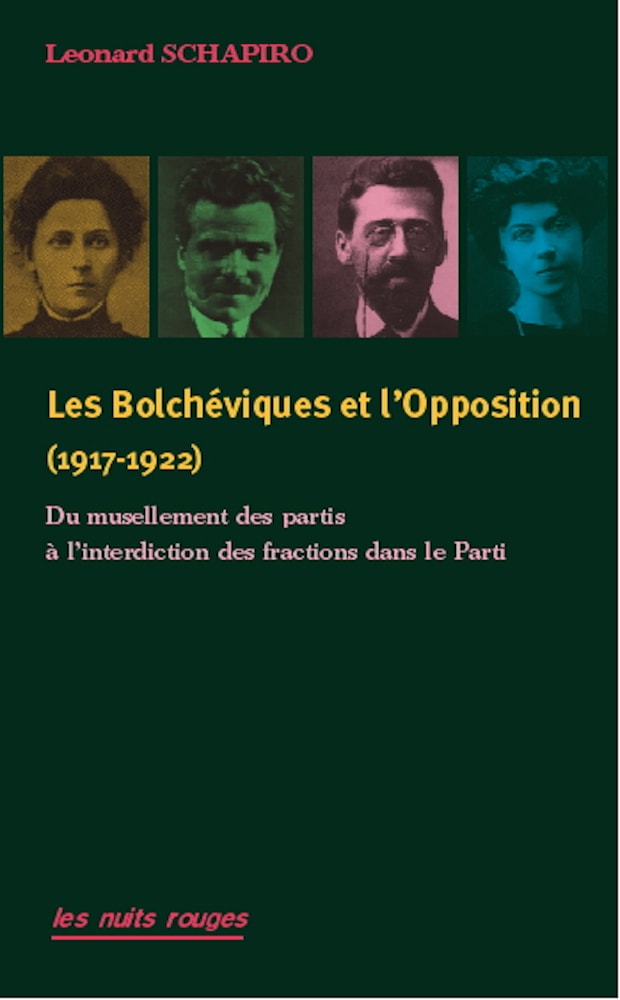Les Bolchéviques et l’Opposition (1917-1922)
Voilà un classique que l’on peut lire même si l’on n’en partage ni les présupposés (Octobre n’a été qu’un putsch mené par un groupe d’hommes décidés) ni la conclusion implicite (les révolutions violentes engendrent des tyrannies). C’est une histoire systématique et détaillée des oppositions au régime communiste russe dans ses premières années, qu’elles se situent à l’extérieur du parti bolchévique (socialistes-révolutionnaires, anarchistes, menchéviques…), ou dans ses propres rangs (Communistes de gauche, Opposition ouvrière, Centralistes démocratiques…). Dès 1955, Schapiro faisait la démonstration, abondamment étayée, que la plupart des procédures et des procédés qui serviront en 1926-27 contre l’Opposition de gauche, puis lors de la « Grande Terreur » des années 1934-38, ont été imaginés, expérimentés et mis au point du vivant de Lénine. Selon lui, il n’y avait donc entre le régime de ce dernier et celui de Staline qu’une différence de degré mais non de nature.
Prix : 22.20€
Description
Lire un extrait
Tiré du chapitre XII : « Premières dissensions au sein du PC ».
En 1920, on pouvait déjà distinguer deux groupes d’opposition au Parti communiste ; on allait leur donner respectivement les noms d’Opposition ouvrière et de Centralistes démocratiques. L’Opposition ouvrière, dont le recrutement était entièrement prolétarien, s’est développée parmi les communistes des syndicats au cours de l’année 1919. Elle est née du mécontentement ouvrier à l’égard de la politique officielle qui consistait à nommer des spécialistes « bourgeois » aux postes responsables des entreprises industrielles. Les chefs de ce groupe, qui se contentait en 1919 de faire entendre ses critiques dans le cadre du parti étaient tous des dirigeants syndicaux, notamment Chliapnikov et Loutovinov. En plus de ses attaques contre les spécialistes de l’industrie, l’Opposition ouvrière s’est mise plus tard à formuler des doléances au sujet du rôle diminué que l’on réservait aux ouvriers dans la gestion de l’industrie et à déplorer ce qu’elle considérait comme une tendance chez les dirigeants communistes à adopter des attitudes bureaucratiques, à oublier le prolétariat et à perdre tout contact avec les masses ouvrières. Un voyageur compétent, qui était venu en Russie et a assisté à la séance du Comité exécutif central du 26 février 1919, pendant laquelle le dirigeant syndical Glébov a parlé des spécialistes tant détestés, a observé « l’indice évident d’un courant politique vers la gauche, qui pourrait ébranler la position bolchévique » (22).
Toutefois, le groupe qui formulait ces critiques ne tenait aucunement à ébranler la dictature du parti. Peu après, lors d’une réunion de la fraction communiste du Conseil central des syndicats, au printemps de 1919, Chliapnikov proposait une résolution aux termes de laquelle les syndicats devaient prendre la tête du mouvement des masses mécontentes et, en le dirigeant et en cherchant à en supprimer les causes, « à combattre de toutes nos forces la tendance à fomenter des grèves en expliquant (aux ouvriers) le caractère désastreux d’une telle politique » (23).
Au cours de l’année 1920, l’Opposition ouvrière ou, plus précisément, les personnalités qui allaient en prendre la tête ont étendu le champ de leurs critiques. Au IXe Congrès du P. C., en mars, Kissélev se plaignait qu’il y avait, « au centre, une grande tendance à détruire, à réduire et à affaiblir l’ensemble du parti dans les provinces » (24).
Contrairement à l’Opposition ouvrière, les Centralistes démocratiques constituaient un groupe d’intellectuels. Leurs chefs, tels qu’Obolensky, Sapronov et Maximovsky, avaient précédemment joué un rôle important dans l’Opposition communiste de gauche en 1918. Cependant, Sapronov était un ancien ouvrier et appartenait à la « vieille garde » bolchévique. Si le but de l’Opposition ouvrière était de défendre les droits des ouvriers contre l’appareil d’Etat, les Centralistes démocratiques se préoccupaient surtout de rétablir l’application des clauses démocratiques, inscrites dans les statuts des soviets et du parti, mais pratiquement négligés dès le début. Ils ne prétendaient pas exprimer les opinions de l’armée, ni celles des syndicats, mais les préceptes de la « culture civile soviétique » (25). Au cours d’une conférence du P. C. qui s’était réunie en décembre 1919 et qui se préoccupait de la structure de l’Etat, Sapronov a réussi, malgré l’opposition de Vladimirsky qui était le porte-parole officiel du parti, à faire adopter son projet de résolution qui prévoyait des modifications dans la composition du Comité exécutif central pour le rendre plus représentatif ainsi que des réformes destinées à rendre un pouvoir effectif aux comités exécutifs des soviets locaux. Un long débat a eu lieu au sujet des projets respectifs de Vladimirsky et de Sapronov à une commission du VIIe Congrès des soviets, réuni immédiatement après la conférence du Parti communiste ; la résolution adoptée en fin de compte était basée sur le projet de Sapronov et contenait la plupart de ses propositions (26). Cette résolution, issue d’ailleurs de l’un des rares débats constructifs conduits en public dans l’histoire soviétique, est demeurée lettre morte.
Dans le courant des années 1919 et 1920, les Centralistes démocratiques recommandaient également d’étendre la liberté au sein du P. C. Ils voulaient que le Comité ne dirige pas le parti, mais le guide suivant une ligne générale, sans se mêler des détails. Ils insistaient pour qu’avant toute décision importante la question soit débattue par les « militants de base », qu’aux élections du parti les minorités soient représentées et qu’elles bénéficient de moyens pour publier leurs opinions (27). En mars 1920, Obolensky déclarait au IXe Congrès du P. C. : « Le camarade Lénine dit que l’essence du centralisme démocratique est contenue dans le fait que le Congrès élit le Comité central, tandis que le Comité central dirige (le parti). Nous ne pouvons approuver cette opinion quelque peu fantaisiste… Nous estimons que le centralisme démocratique… consiste à mettre en application les directives du Comité central par (l’intermédiaire) des organismes locaux, dans l’autonomie responsable de ces derniers et dans leur responsabilité pour leur domaine de travail » (28).
Aucun de ces deux groupes ne constituait une opposition dans le sens réel de ce terme. Ils n’avaient ni structure distincte, ni effectifs fixes, ni journaux ou autres publications propres, ni programme ou politique à proposer à la place du programme officiel des communistes. Le nom même d’Opposition ouvrière est, semble-t-il, un surnom inventé bien plus tard, à la fin de 1920 ou au début de 1921, par Lénine lui-même. Les membres de ces groupes n’étaient guère plus que les protagonistes d’un idéalisme quelque peu utopique. Ils étaient en même temps des partisans convaincus de ce que beaucoup de gens prenaient pour des principes essentiels du parti au sein d’un groupement qui leur semblait atteint d’une dégénérescence rapide. Ils acceptaient la politique énoncée par le parti et, après avoir discuté, ils votaient pour les résolutions même lorsqu’ils ne les approuvaient pas entièrement. L’Opposition ouvrière et les Centralistes démocratiques ne sont devenus de véritables groupes d’opposition qu’en 1921 et encore parce que le Comité central les y a obligés, ainsi qu’on le verra au chapitre XV.
En 1920, la situation devenait également critique dans les syndicats. On ne pouvait pas les considérer à l’époque comme représentant l’opinion du prolétariat. Parmi eux, les membres communistes ne constituaient qu’une fraction du total : environ 500 000 sur 7 millions de syndiqués selon les chiffres officiels de 1921 (29). Cela ne les empêchait pas d’agir uniquement par le canal des instances et des responsables communistes. A toutes les conférences, c’étaient les communistes qui avaient la majorité écrasante ; si, comme on l’a vu souvent, même les élections manipulées ne produisaient pas une majorité communiste jugée assez forte, les autorités avaient recours à la force pour obtenir le résultat souhaité : on dissolvait de force les comités centraux des syndicats non communistes, comme ce fut le cas pour les ouvriers typographes de Moscou. Vers la fin de la guerre civile, le gouvernement lui-même ne dissimulait pas que la majorité du prolétariat russe était anticommuniste. Au début de 1921, Vychinsky, transfuge menchévique récent, qui exerçait ses talents en organisant des débats d’ouvriers « sans parti » pouvait considérer comme un signe de progrès le fait qu’une résolution communiste ait obtenu 760 voix sur 900 à l’une de ces réunions (30) : Lénine le reconnaissait au Xe Congrès du parti : « Nous n’avons pas réussi à convaincre les masses » (31).
Ici il convient d’examiner la domination exercée par les fractions communistes au sein des syndicats, car c’est là qu’en 1920 l’opposition à la politique officielle du P. C. se dessinait rapidement. Durant les quelques mois qui ont suivi la révolution, les syndiqués communistes n’avaient guère montré de résistance à accepter l’objectif officiel qui consistait à transformer les syndicats en exécutants de la politique d’Etat au lieu d’être les défenseurs des droits ouvriers. Il leur paraissait logique qu’après la victoire de la classe ouvrière, il ne pourrait pas y avoir d’opposition entre l’Etat ouvrier et les groupements des travailleurs ; à leur premier Congrès panrusse de janvier 1918, les syndiqués communistes, qui avaient obtenu 66 % des sièges de délégués, approuvaient cette proposition de principe. Ils reconnaissaient aussi que les comités d’usines devaient s’intégrer à un appareil central dont ils formeraient les ramifications syndicales (32).
A cette époque, les syndiqués communistes n’avaient guère tendance à approuver l’opposition non communiste en matière de questions syndicales. Ce furent surtout les menchéviques et l’ancien communiste Lozovsky qui s’opposèrent publiquement en 1918 à la politique communiste consistant à supprimer toute indépendance syndicale (33). Même le programme, rédigé à la fin de 1918 par le Conseil suprême de l’Economie nationale et destiné à en finir avec l’intervention anarchique des comités ouvriers d’usines dans la gestion de l’industrie, n’a pas soulevé d’opposition immédiate de la part des syndiqués communistes. Ils acceptaient sans réserve le principe selon lequel il fallait transférer à l’Etat les pouvoirs du contrôle ouvrier et le laisser les exercer désormais au sommet par l’intermédiaire du Conseil suprême de l’Economie nationale et des syndicats, tandis que la direction des syndicats agirait à son tour par l’intermédiaire de comités locaux en partie élus et en partie nommés, et tous rigoureusement subordonnés au centre. Au début de 1919, le IIe Congrès des syndicats étouffait sous les quolibets les avertissements des menchéviques, et la résolution communiste, adoptée à l’unanimité avec deux abstentions – car les menchéviques n’avaient pas le droit de vote – dénonçait sans ménagement le mot d’ordre de l’indépendance syndicale comme un paravent derrière lequel, disait-on, se dissimulait en réalité une attaque contre le régime communiste ; elle reconnaissait en outre que désormais les syndicats étaient « passés du contrôle de la production à son organisation en participant activement à la fois à la gestion des entreprises locales et à la vie économique du pays entier » (34).
Ce congrès a approuvé aussi la concentration et la centralisation des groupements syndicaux sur le plan professionnel, car jusqu’à cette date ils avaient eu une structure assez disparate. Cette centralisation fut achevée en 1921 (35). Si une certaine gêne commençait à pénétrer parmi les militants communistes ouvriers à propos du déclin de leur influence dans la gestion de l’industrie – et, dans son discours au Congrès, Martov n’a pas manqué de faire allusion à l’existence de désaccords à ce suje t–, rien ne transpirait au dehors. Cependant, une promesse officielle venait adoucir les ordres de centralisation. On la trouve dans le programme du parti, adopté en mars 1919 : « Etant déjà… des participants dans les organes locaux et centraux de la gestion des industries, les syndicats doivent parvenir à concentrer entre leurs mains la direction de l’économie nationale tout entière en tant qu’unité économique » (36).
Plus tard, cette promesse a servi de sujet à un débat acerbe. Ceux des syndiqués communistes qui critiquaient le gouvernement insistaient sur le fait qu’ils ne réclamaient que sa réalisation. Il est vrai qu’en un sens les syndicats participaient au système central de contrôle par l’intermédiaire des directoires instaurés par le Conseil suprême de l’Economie nationale. Des représentants syndicaux siégeaient au centre dans le praesidium du Conseil suprême et dans les organes analogues des conseils inférieurs qui fonctionnaient dans les goubernii. On accordait également aux syndicats un siège dans les directoires gouvernant les branches industrielles et établis par le Conseil suprême, ainsi que dans les sous-directoires. En 1920, le pourcentage des membres des comités de gestion des usines, classés dans la catégorie des « ouvriers », était de 63 %, tandis qu’il était de 26 % dans les conseils de gestion ou collèges des principaux directoires industriels (37).
Néanmoins, les syndiqués communistes subissaient la même évolution que l’ensemble du parti : un conflit se précisait entre les militants et les dirigeants des syndicats. La participation à l’appareil centralisé favorisait les communistes professionnels qui obtenaient les privilèges attachés à la condition de hauts fonctionnaires du gouvernement. Elle ne donnait aucune satisfaction aux ouvriers ordinaires membres du P. C., qui sentaient qu’on les éliminait peu à peu de toute participation à la gestion et qu’on les soumettait aux ordres des personnalités du parti. Il est bien compréhensible qu’ils se souvinssent avec nostalgie des premiers jours de la révolution, où les comités ouvriers faisaient la loi dans l’usine. Parmi les communistes syndiqués que les bolchéviques avaient recrutés au sein de ces comités ouvriers d’usines, beaucoup avaient été gagnés sur la promesse du contrôle ouvrier, revendication qui était pour eux l’essence même du communisme. Dorénavant, ils comprenaient ce que J. S. Mill voulait exprimer en disant : « Le peuple qui exerce le pouvoir n’est pas le même peuple sur lequel il est exercé. » Selon un historien soviétique officiel des syndicats : « Le transfert du centre de gravité de l’activité vers les sommets des syndicats entraîna toute une série de résultats anormaux et malsains : la désaffection des masses, la perception insuffisante de ce qui se passait à la base et une attitude formaliste envers les simples militants » (38).
Les ouvriers communistes étaient mécontents également du fait que les postes dirigeants de l’industrie étaient occupés par des experts « bourgeois » ou « spécialistes ». Au début de 1919, ce mécontentement avait trouvé un porte-parole particulièrement ferme en la personne de Chliapnikov, qui était alors président du Syndicat des métallurgistes et membre du Conseil central des syndicats. Ses critiques vigoureuses, dont on a déjà parlé ci-dessus, étaient sans doute particulièrement gênantes pour les dirigeants communistes et il n’y a rien de surprenant qu’au cours de l’année on l’ait envoyé pour une mission prolongée en Norvège ; enfin son remplacement par Goltsman au poste du président du Syndicat des métallurgistes aurait pu faire naître le soupçon qu’on l’avait éloigné à cause de son opposition. Lénine a vigoureusement nié cette accusation qui, par ailleurs, était probablement injustifiée (39). Les représailles contre les critiques étaient encore l’exception plutôt que la règle au sein du P. C. de 1919.