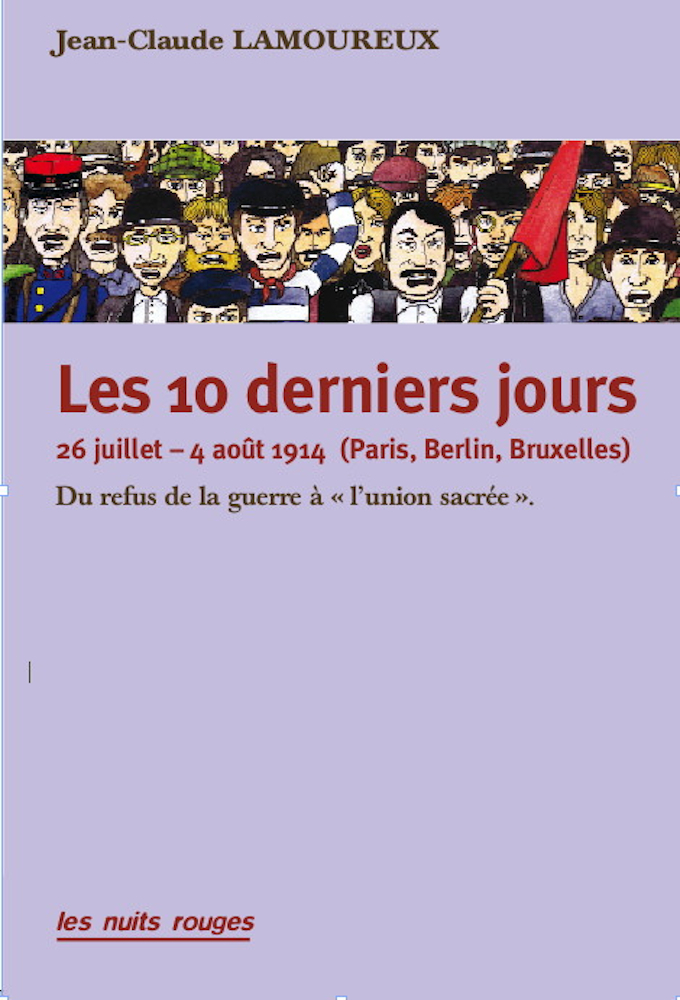Les 10 derniers jours
Cette chronique parallèle, au jour le jour, des événements survenus principalement à Paris et à Berlin dans les jours précédant le début de la guerre européenne de 1914-18 s’intéresse en priorité à l’évolution de l’opinion des classes ouvrières allemande et française, ainsi qu’à celle de leurs organisations qui, presque seules, ont tenté un temps d’empêcher le carnage annoncé. Elle ne néglige pas pour autant les événements politiques et militaires, qui sont ainsi décrits dans leur soubassement sociologique et idéologique. L’histoire sociale de cette période cruciale, traitée souvent à part dans des ouvrages spécialisés, ainsi intégrée à l’histoire tout court, permet de comprendre comment, sous prétexte de défendre leurs patries soi-disant menacées, des millions d’ouvriers, de paysans, d’employés, de commerçants, de petits bourgeois français, allemands, russes, autrichiens, italiens, anglais, hongrois et d’autres nationalités, ont été conduits à la mort ou à la mutilation pour le bénéfice principal des industriels.
Prix : 10.00€
Description
Lire un extrait
29 juillet 1914
(…) A Bruxelles, un meeting est organisé dans la soirée, présidé par l’avocat Emile Vandervelde, chef du Parti ouvrier belge, qui entrera bientôt au gouvernement. 10 à 20 000 personnes, selon les sources, se pressent dans la salle du Cirque royal et au dehors. Haase parle dans sa langue maternelle, comme la plupart des orateurs. Il met l’accent sur la responsabilité de Vienne : « L’Autriche semble compter sur l’Allemagne, mais les traités secrets n’engagent pas le peuple. » Il affirme que « le prolétariat allemand estime que l’Allemagne ne doit pas intervenir, même si la Russie intervient ». Et il conclut par une menaçante péroraison, qui peut s’interpréter aussi comme un conseil donné aux gouvernants : « Que nos ennemis prennent garde. Il se pourrait que les peuples, fatigués de tant de misère et d’oppression, s’éveillent enfin et établissent la société socialiste. » Malgré ces fermes propos, le leader allemand a toutefois confié un peu plus tôt au socialiste lituanien, membre du PSU, Charles Rappoport, que « si la France était seule en jeu, notre attitude serait facile. Mais il y a les Russes. Ce que représente pour vous la botte prussienne, c’est pour nous le knout russe ».
Dans son discours, souvent interrompu par des applaudissements, « le citoyen Jaurès » s’en prend durement à « l’Allemagne officielle » : « Si elle a connu la note austro-hongroise, elle est inexcusable (…) ! Et si elle n’a pas connu la note autrichienne, quelle est sa sagesse gouvernementale ? Quoi ! vous avez un contrat qui vous lie et qui vous entraîne à la guerre, et vous ne savez pas ce qui va vous y entraîner ? Je demande, ajoute Jaurès, quel peuple a donné un exemple pareil d’anarchie ? » Il se risque ensuite à affirmer que « nous, socialistes français (…) n’avons pas à imposer à notre gouvernement une politique de paix, il la pratique » et aussi que « le gouvernement français est le meilleur allié de paix de cet admirable gouvernement anglais qui a pris [une] initiative de conciliation » la veille. Ce qui provoque les cris de «Vive la France !» dans l’assistance. Et, sans forcer son talent, l’orateur conclut : « Hommes humains de tous les pays, voilà l’œuvre de paix et de justice que nous devons accomplir ! » Sur quoi, souffrant de migraine, il rentre à l’Hôtel de l’Espérance – il en fallait à cette heure ! –, où on lui avait réservé une chambre, sans participer à la manifestation qui suit le meeting. Le leader socialiste trouve néanmoins la force d’écrire un article, dont la note optimiste est un peu forcée, qui paraîtra le surlendemain dans L’Humanité, le jour de son assassinat. Il y affirme que « partout, les socialistes ont la conscience de leur devoir ». Certes, « la situation est grave, à coup sûr, mais toute chance d’arrangement pacifique n’a pas disparu ». Le plus grand danger, selon lui, réside « dans l’énervement qui gagne, dans l’inquiétude qui se propage, dans les impulsions subites qui naissent de la peur, de l’incertitude aiguë, de l’anxiété prolongée ».
A Berlin, la tragi-comédie se joue pour l’instant sur trois plans. Au premier, les journaux du SPD continuent de prêcher la paix et appellent la population à faire entendre son refus de la guerre, ou plus exactement son désir de paix. Au second, les autorités annoncent que les cortèges et les démonstrations qui, vu la situation politique, avaient été parfois tolérés ces jours-ci, sont à partir d’aujourd’hui « interdits à cause du trouble causé à la circulation ». Mais les choses importantes se jouent en coulisses.
Pendant l’absence de Haase, un des leaders de la droite du Parti social-démocrate, Albert Südekum, a adressé une lettre au chancelier qui lui confirme l’accord de ses amis Friedrich Ebert, Otto Braun, Hermann Müller, Friedrich Bartels et Richard Fischer pour s’abstenir de toute grève ou action de sabotage. Député de Nuremberg et journaliste de profession, Südekum est, avec David, Legien et Noske, un des leaders de la droite du parti, tous favorables aux thèses « révisionnistes » développées par Eduard Bernstein dans les années 1890, et même au colonialisme, mais aussi plus engagés que l’ancien secrétaire d’Engels dans la collaboration avec le régime impérial. Très déférent, Südekum assure Bethmann que « la démarche entreprise par votre excellence pour une communication directe (…) a été accueillie avec reconnaissance ». Il expose qu’il a obtenu de la direction socialiste de son parti « qu’aucune action sortant de l’ordinaire (grève générale ou partielle, sabotage et autres actions de ce type) n’a été prévue ni n’est à craindre », et cela en désir de « sauver la paix ». Il ajoute : « La direction du parti, qui a parfaitement conscience de ses responsabilités, reconnaît aussi la nécessité impérieuse d’éviter les déclarations ambiguës (…) dont pourraient tirer profit les partis de la guerre dans divers pays. » Il demande aussi le retour de l’économiste autrichien Rudolf Hilferding, le célèbre auteur du Capital financier, qui collaborait au Vorwärts, renvoyé récemment – on ne sait trop pourquoi – dans son pays. Südekum expose que ce collaborateur « semblait remarquablement convenir en vue d’imposer au sein du journal le désir intense de paix de mon parti » et vante sa « parfaite connaissance des doléances autrichiennes contre la Serbie ». L’arrêté d’expulsion sera annulé. C’est au cours de ces tractations que le gouvernement impérial achève de se convaincre de ne pas appliquer l’intégralité des mesures prévues par le « plan de mobilisation intérieure ». Comme l’exposait dans une dépêche le représentant à Berlin du gouvernement bavarois, en parlant des sociaux-démocrates : « Le gouvernement impérial les connaissait mieux qu’ils ne se connaissaient eux-mêmes. »
A Paris, la journée s’annonce chargée avec le retour de Poincaré et de Viviani à Paris dans l’après-midi et le meeting de la CGT en début de soirée. La manchette de La Bataille syndicaliste est barrée d’un martial « Guerre à la guerre ! » sur six colonnes. L’article principal est jugé « très violent » par Alfred Rosmer. « La tragédie qui s’annonce », écrit Michel Della Torre, qui n’est pas un collaborateur régulier du journal, « mettra face à face, pour le combat final, non plus les nations, mais la classe ouvrière et la classe capitaliste, le Peuple et les parasites, ceux qui vivent de leur travail et ceux qui vivent du travail des autres ». Et d’appeler à « la Révolution ouvrière » qui empêchera « l’heure de la Folie, de la Crapule et du Crime » de sonner. Le même Della Torre vitupérera, dès septembre, dans le même journal, contre les « bandits couronnés et soudards teutons (qui) ont ouvert les écluses du sang ». Mais le journal se garde bien de prôner des actions précises, se contentant d’invoquer « la protestation populaire » pour qu’elle « s’élargisse » et aille « se fortifiant, s’intensifiant, au fur et à mesure que les dangers deviendront plus pressants ».
A la gare du Nord, une foule de patriotes et de curieux se prépare à faire un accueil « triomphal » à Poincaré et à Viviani lorsqu’ils descendront du train qui les ramène de Dunkerque. Des scènes touchantes se déroulent parmi les gens qui patientent, comme celle-ci que décrit Le Matin :
« Barrès vit soudain venir à lui M. Edmond Rostand, qu’accompagnait son fils [Jean, le futur biologiste pacifiste].
— Voulez-vous m’inscrire tout de suite à la Ligue des patriotes ? demanda l’auteur de Cyrano.
M. Maurice Barrès accéda sur le champ à ce désir et remercia avec effusion l’illustre poète. »
Le train arrive vers 13 heures 30. Les deux dirigeants sont accueillis par une flopée de ministres, ambassadeurs, et autres généraux. Ils prennent place ensuite dans un landau qui les emmène à l’Elysée sous les acclamations de dizaines de milliers de Parisiens.
Chez les syndicalistes, on prépare la réunion de ce soir aux salles Wagram. Mais, vers 17 heures, coup de théâtre. On apprend que le Conseil des ministres, réuni par Poincaré dès son arrivée dans son palais, a imposé à Malvy l’interdiction du meeting. C’est au cours de cette réunion que le ministre de la Guerre, Messimy, se livre à une nouvelle rodomontade contre les opposants à la guerre, rapportée par La Bataille… du lendemain. « Laissez-moi la guillotine, et je garantis la victoire », lance-t-il en ajoutant : « Que ces gens-là ne s’imaginent pas qu’ils seront enfermés en prison. Il faut qu’ils sachent que nous les enverrons aux premières lignes de feu ; s’ils ne marchent pas, eh bien ! ils recevront des balles par-devant et par-derrière. Après, nous en serons débarrassés. » Seul son collègue Malvy, radical-socialiste comme lui, proteste contre ces propos inappropriés. Par la suite, le même Messimy proposera deux fois à Joffre de faire fusiller les généraux incapables lors des revers d’août subis par les Français. Le général en chef, plus soucieux de la vie de ses officiers que de celle de ses soldats (il y eut des dizaines de fusillés dans les premières semaines du conflit), refusera évidemment d’en arriver à une telle extrémité.
Confrontée à la décision gouvernementale, la CGT décide de s’incliner. Cependant, de nombreux protestataires, qui n’ont pu être prévenus ou qui veulent passer outre, arrivent vers 20 heures à la station de métro Ternes ; les stations environnantes ayant été fermées. Les ouvriers, reconnaissables à leur bourgeron et à leur casquette traditionnels, sont particulièrement visés, rapportent les militants. Toutefois, certains, venus de Belleville et de Montmartre, parviennent à se masser place des Ternes. La police les entoure et les charge quand elle « jugea que les manifestants étaient assez nombreux », comme l’écrira La Bataille du lendemain. Mais les protestataires ne se laissent pas faire. Pendant plusieurs heures, le quartier est le théâtre d’affrontements.
Par ailleurs, une dizaine de réunions et de défilés de protestation se tiennent en banlieue et à Paris, appelés par des sections PSU ou des unions CGT. Deux meetings se déroulent dans les salles de la Bellevilloise, rue Boyer, et de l’Egalitaire, rue Sambre-et-Meuse, toutes les deux dans l’est de Paris. Le Petit Parisien parle d’«auditoires nombreux» et se félicite de ce que, grâce aux mesures prises par les organisateurs, les forces de police massées aux abords n’aient pas eu à intervenir. Un peu avant, 500 employés de la Compagnie des omnibus ont envahi, depuis les ateliers et les garages de la rue Championnet, le boulevard Ornano aux cris de « Conspuez la guerre ! », rapporte Le Matin, et poursuivi leur manifestation jusqu’à la mairie du XVIIIe arrondissement. (…)