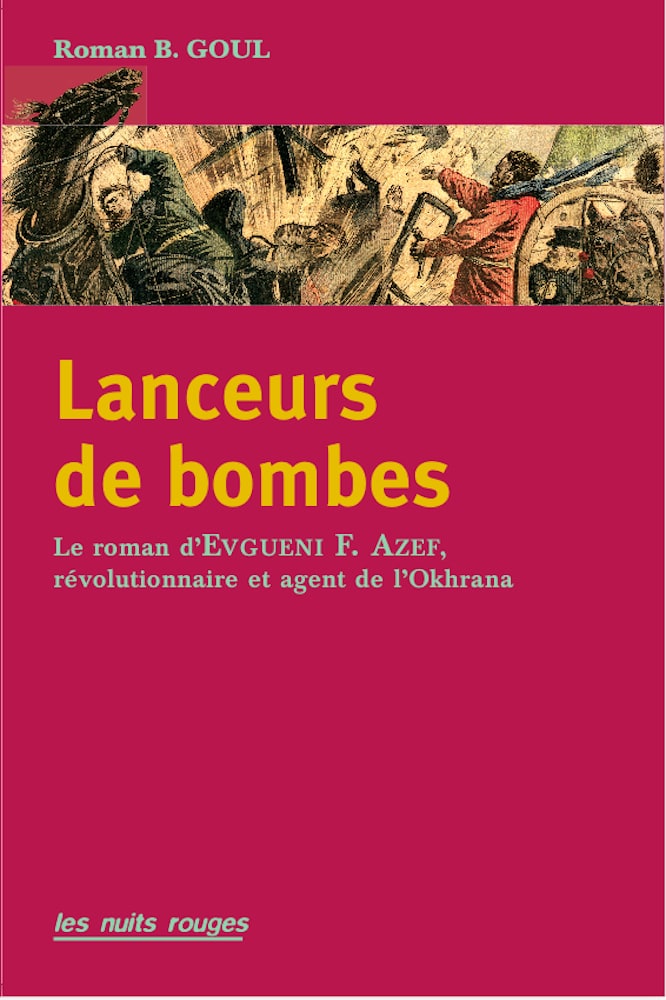Lanceurs de bombes
En 1908, la révélation qu’Evgueni Filippovitch (dit Evno) Azef, chef de l’Organisation de combat du Parti socialiste-révolutionnaire russe, qui avait organisé quelques années plus tôt les assassinats du ministre de la police Plehve et du grand-duc Serge, émargeait à la comptabilité de l’Okhrana fit stupeur en Europe. Pour sa défense, l’agent double avança, comme plus tard Roman Malinovski chez les bolchéviques, que les résultats de son action avaient finalement plus profité au parti qu’à la police.
La réédition annotée et illustrée de cet excellent roman du garde blanc repenti Roman Goul, découpé comme un scénario de cinéma, nous transporte de Moscou et de Pétersbourg à Paris et à Genève, en passant par Berlin, Kharkov, Saratov, Varsovie… Il nous fait partager la vie de ces militants qui sacrifiaient le plus souvent leur vie (au moins leur liberté) pour abattre le tsarisme par l’assassinat de ses figures de proue. Centré sur le subtil et fascinant double jeu d’Azef, ce « roman documentaire » aux allures de thriller est fondé sur des faits réels, tels que rapportés notamment par Boris Savinkov, son second et successeur, dans ses « Souvenirs d’un terroriste » (1917).
Traduit du russe par Norbert Guterman (1930 & 1963). Nouvelle édition annotée.
Prix : 17.30€
Description
Lire un extrait
Présentation (extrait).
Outre ses qualités littéraires, la réédition annotée de ce « roman documentaire » est justifiée par la personnalité de son acteur principal, Evgueni Filippovitch Azef, un des plus célèbres et fascinants agents secrets de l’histoire. Car, à la différence d’autres agents doubles ou triples qui ont nourri les chroniques judiciaires ou excité l’imagination des écrivains, sa carrière nous permet d’aborder plusieurs sujets d’importance et toujours d’actualité. A savoir, d’une part, le rôle des manipulations policières dans l’histoire ; et la question du terrorisme et des attentats-suicides, d’autre part.
Né en 1869 dans l’actuelle Biélorussie au sein d’une famille d’artisans, membre du courant socialiste-révolutionnaire depuis les années 1890, Azef émargeait aux services secrets du tsar depuis la même date approximativement. Selon l’historienne Anna Geifman – très hostile par ailleurs aux mouvements révolutionnaires de toute sorte –, il aurait offert ses services à l’Okhrana alors qu’il s’était exilé en Allemagne suite à un petit larcin commis à Rostov/Don où il avait passé sa jeunesse. Dans ce pays, il suit avec succès des études d’ingénieur (mécanique, puis électrodynamique) et fait apprécier ses qualités militantes dans les cercles S.-R. qu’il fréquente, tout aussi bien que la précision de ses mouchardages chez ses officiers traitants. C’est en mai 1903 (peut-être avant…), à la suite de l’arrestation de Grigori Guerchouni, chef de l’Organisation de combat (O. C.), qu’il prendra progressivement la tête de cette structure, en collaboration étroite avec Boris Savinkov. Avant cela, il avait été l’un des principaux artisans de l’unification des groupes S.-R. dans le Parti socialiste-révolutionnaire proprement dit, fondé en 1901.
Il est en mesure de présenter bientôt un bilan avantageux de son action, dont les points forts sont les assassinats du ministre de l’Intérieur Plehvé en juillet 1904 et du grand-duc Serge, gouverneur militaire de Moscou en février 1905 – tous deux réactionnaires et antijuifs. Il est accueilli triomphalement à Genève par la direction du parti qui y tenait ses quartiers, et sa réputation dans le mouvement est alors à son zénith. Mais, inexplicablement, c’est à compter de cette date que les actions terroristes entreprises par Azef marquent le pas, c’est-à-dire qu’elles n’aboutissent pas, suite à des arrestations inopinées, ou qu’elles échouent. Le parti pâtit aussi de l’activité délétère du révolutionnaire retourné Nikolaï Tatarov, qui paralysa l’O. C. de mars à octobre 1905.
Les S.-R. réussissent tout de même à abattre en 1906 cinq généraux, dont le préfet de police de Pétersbourg, von Launitz, en janvier 1907, mais il s’agissait d’opérations qu’Azef n’avait pas suivies jusqu’au bout. En accord avec le CC, mais non avec les boeviki du secteur terroriste, l’homme avait adopté une ligne modérée, prônant la fin du terrorisme après la publication par le tsar, au terme d’une année 1905 agitée, du Manifeste d’octobre qui promettait une Douma élue au suffrage universel. De fait, l’Organisation de combat ralentit son activité, mais les actions armées n’en continuent pas moins, menées par les structures régionales du parti. Il faut y ajouter la « terreur économique », incendies et autres coups de main perpétrés par des groupes locaux contre les grands propriétaires terriens et les industriels des villes.
Cependant, Azef, qui relâche aussi ses relations avec l’Okhrana, de peur que des imprudences ne viennent confirmer les soupçons récurrents qui pèsent sur lui, vu le nombre des arrestations, sera néanmoins contraint de prendre part à l’organisation d’actions « centrales », ratées il est vrai mais de peu, contre l’amiral Doubassov en décembre 1906 et le tsar lui-même en septembre 1908. Au total, précise Jacques Baynac, « de 1902 à 1908, l’O. C. ne commit que 13 attentats, mais les détachements mobiles et les brigades locales, rattachées au PS-R, en commirent 187 autres ». De sorte que « 139 personnes furent tuées par les S. R., 85 blessées et que seulement 16 des cibles en réchappèrent saines et sauves ». La part attribuable à Azef dans ce bilan est donc modeste, mais la qualité des cibles en compensait la faible quantité. C’était en tout cas ce que pensa longtemps le parti S.-R. avant que les révélations du menchévique Bourtzev ne provoquent en 1908 la chute retentissante du chef de l’O. C.
Selon Baynac, et d’autres auteurs, Azef était bien un traître mais qui avait son agenda politique particulier, distinguant les personnalités qu’il ne fallait pas tuer de celles qu’on pouvait tuer et de celles que l’on devait tuer : « Sa tactique semble avoir essentiellement consisté à faire liquider les révolutionnaires qui gênaient son ascension par les policiers, et réciproquement. » Ce pourrait avoir été le cas de Plehvé. Car les ascendants d’Azef étaient juifs. Mais, selon Geifman, il n’avait jamais montré de solidarité particulière avec sa communauté d’origine. Cette auteure rejette donc l’hypothèse du meurtre prémédité, retenue en revanche par Savinkov 6 et Goul dans leurs ouvrages respectifs. Elle révèle qu’Azef avait donné divers renseignements (quoique volontairement incomplets par prudence) au directeur de la police Lopoukhine avant les attentats contre Plehvé et Sergueï, qui n’auraient finalement réussi que grâce à l’incompétence de la police pétersbourgeoise. Pour cette historienne israélienne, loin d’être un provocateur machiavélique, frotté d’hégélianisme, le chef de l’O. C. n’aura été qu’un vulgaire mouchard, froussard de surcroît, complexé par son apparence physique et uniquement motivé par sa soif de lucre et de revanche sociale. Elle lui reconnaît cependant des « facultés intellectuelles supérieures ». Mais, par ailleurs, il ne semble pas que l’homme ait été porteur d’un bagage culturel autre que scientifique. Très peu familier de la littérature socialiste, il apparaît même comme ne partageant nullement les espoirs révolutionnaires du parti. Son train de vie luxueux – que menait aussi Savinkov –, permis par les confortables émoluments qu’il recevait de ses deux employeurs, plaide en ce sens : casinos, bons restaurants, opium, bonnes bouteilles, « petites femmes », wagons-lits…, le bonhomme ne se refusait pas grand-chose. C’est d’ailleurs pour avoir prétendu faussement être descendu dans un hôtel miteux de Berlin en 1908, alors qu’il était à Pétersbourg pour convaincre son ancien chef flic Lopoukhine de revenir sur ses dénonciations (voir plus loin), qu’il convaincra le CC du parti de sa duplicité. Ses idées politiques, les rares fois où il les exprimait, surtout après 1905, renforcent la thèse défendue par Baynac et d’autres d’un démocrate bourgeois que seul le caractère despotique du tsarisme contraignait à des actions homicides. C’était d’ailleurs l’opinion dominante en Europe en ces années, y compris à droite, que la lutte contre le tsarisme excusait ces excès terroristes qu’on n’aurait pas tolérés ailleurs.
Etait-il bon ? était-il méchant ? Alors, vulgaire mouchard ou manipulateur de génie, il est difficile de trancher en l’état de la documentation disponible, encore fragmentaire et parfois contradictoire Mais les deux thèses ne sont pas incompatibles. On remarquera simplement que Savinkov dans son ouvrage (que suit Goul quant au déroulement des faits) ne peut rétrospectivement dissimuler un certain respect pour l’homme, décrit comme « un révolutionnaire de talent et d’expérience, ainsi qu’un homme ferme et résolu ». Il reste qu’il n’a jamais participé directement à un attentat, mais il est vrai aussi que les généraux ne montent que rarement en ligne.
Après la découverte de sa félonie, Azef fut dénoncé dans le parti comme un provokator. Si le mot avait en russe la même valeur qu’en français, il ne mériterait pas cette qualification, n’ayant jamais poussé le parti à des actions qui auraient pu justifier une répression. Tout au contraire, il n’a fait qu’exécuter avec plus ou moins de réticence les ordres de la direction, la poussant même assez tôt à abandonner le terrorisme. A l’Okhrana, les « provocateurs » étaient des agents qui jouaient un rôle actif, et donc subversif, dans l’organisation qu’ils avaient infiltrée – le plus souvent pour fonder ou maintenir leur réputation militante. Ce n’étaient pas de simples « informateurs » ou des « agents d’infiltration ».
Avec le recul, on doit admettre que l’Okhrana et le PSR en ont eu finalement pour leur argent, et à peu près équitablement. Cette opinion n’était évidemment pas partagée par les victimes de ses dénonciations, dont plusieurs ont fini sur la potence. Comme tous ceux de son espèce, mais aussi comme tous les dirigeants de second rang des institutions de tout ordre, Azef a louvoyé, sachant opportunément ignorer ou saboter les ordres de ses employeurs, ressentant peut-être de la jouissance à tromper aussi longtemps tout le monde et à se croire « le maître de son destin, le capitaine de son âme ». A moins qu’il ne faille le ranger plus misérablement dans la catégorie de ces « aventuriers qui ne croient en rien, blasés sur l’idéal qu’ils ont naguère servi, épris du danger, de l’intrigue, de la conspiration, d’un jeu compliqué où ils dupent tout le monde. Ceux-là peuvent avoir du talent, jouer un rôle à peu près indéchiffrable ».
Des « provocateurs » ou des « agents doubles », le mouvement ouvrier russe en connut plusieurs, de calibres bien différents. Sergueï Dégaïev (1857-1920) était à la fois un dirigeant de Narodnaïa Volia (Volonté du peuple) et un agent de la police qui joua double jeu avec un art consommé et livra de nombreux militants. Démasqué en 1883, il sauva sa vie en attirant Soudeïkine, le chef de la police secrète de Pétersbourg, dans son appartement pour le livrer aux coups mortels de ses camarades.
Arkady Mikhaïlovich Harting était lui un vrai provocateur, au sens français du terme. Avant de diriger la stratégique direction parisienne de l’Okhrana entre 1905 et 1909, il avait établi en 1890 au Raincy, avec Piotr Ivanovitch Rachkovsky (à qui il succédera dans ce poste), un atelier de fabrication de bombes destinées à tuer Alexandre III. Lorsque les bombes furent prêtes, il dénonça le groupe de révolutionnaires – que par ailleurs il avait recruté – à la Sûreté parisienne, qui les coffra. Le but de l’opération était d’ouvrir une brèche dans le soutien dont jouissaient dans l’opinion française les révolutionnaires russes.
Il y eut aussi Gapone, le pope qui conduisit une foule ouvrière présenter humblement une pétition au « Petit Père des peuples », lors du « Dimanche sanglant » du 9 janvier 1905 – début des troubles qui dureront toute cette année. Auparavant, la police avait incité ou encouragé Gapone à monter une Union ouvrière, assez peu subversive il est vrai, mais qui servit effectivement un temps à relayer les revendications populaires. On a dit de ce prêtre que, comme Azef, ses liaisons tarifées avec la police ne l’empêchaient pas de vouloir l’amélioration de la condition ouvrière et un régime plus démocratique. Il jouait ainsi sur les deux tableaux.
Mais le plus célèbre, outre Azef, de ces agents fut Roman Malinovski, son équivalent chez les bolchéviques. Surnommé le Tailleur, bien qu’il fut d’abord serrurier avant de diriger le syndicat des métallos, remarqué par un Lénine en recherche de militants ouvriers, il fait son chemin dans le parti et dirigera entre 1912 et 1914 le groupe parlementaire bolchévique à la Douma. Soupçonné en 1914 d’ « en croquer », il est cependant blanchi par une commission où siégeait Lénine. Engagé dans l’armée, Malinovski tombe aux mains des Allemands et reprend son apostolat dans le camp de prisonniers où il échoue. Pris de remords après la guerre, il commet l’erreur de revenir en Russie où entre-temps la vérité s’était faite jour. Comme on était dans l’embarras, on le jugea et puis on le fusilla… Il faut noter que comme Tchernov pour Azef, Lénine le soutint quasiment jusqu’au bout. Après sa mort, ce dernier ne manquait pas de souligner qu’au total le Tailleur avait rendu au parti plus de services qu’il ne lui avait causé de dommages.
Les limites de l’infiltration policière.
Dans son livre sur le sujet, Victor Serge décrit la provocation comme une arme à double tranchant pour les pouvoirs établis. D’abord, elle les expose à être les dupes des gens qu’ils manipulent. Ainsi, Stolypine, « bien au courant de ces choses, se faisait accompagner dans ses sorties par le chef de la police Guérassimov dont la présence lui paraissait une garantie contre les attentats commis à l’instigation de provocateurs. Stolypine fut d’ailleurs tué [en 1911] par l’anarchiste Bogrov qui appartenait à la police ». Serge affirme que « la provocation, en atteignant une telle ampleur, devint par elle-même un danger pour le régime qui s’en servait, et surtout pour les hommes de ce régime ». Il est ainsi possible, mais non certain, que l’assassinat de Plehvé se soit inscrit dans le cadre plus vaste d’un complot interne au régime, mené par des politiciens rebutés par l’intransigeance de ce ministre ou qui voulaient simplement accéder au pouvoir. Ce qui expliquerait que les renseignements fournis par Azef n’aient pas été exploités. Ratchkovski, chef de l’Okhrana de Paris entre mars 1885 et novembre 1902, accusa ainsi le chef, relativement libéral, du Département de la police Lopoukhine, à qui il devait la perte de son poste parisien, d’incompétence coupable. Plus tard écarté à son tour, Lopoukhine se serait vengé en révélant le rôle de l’agent Azef.
Mais on entre ici sur un terrain hautement spéculatif qu’il vaut mieux laisser aux historiens et aux romanciers spécialisés dans les affaires secrètes. Contentons-nous de dire sans grande originalité que les manœuvres ou provocations policières ne peuvent que freiner le cours de l’histoire, mais jamais l’inverser. Bien heureuses encore quand, suite à des initiatives intempestives, elles ne l’accélèrent pas… Il faut compter aussi sur la bêtise consubstantielle aux régimes condamnés. Serge remarque encore que s’ « il y avait bien au sommet (de l’Okhrana) quelques hommes intelligents, quelques techniciens d’une haute valeur professionnelle, (…) toute la machine reposait sur le travail d’une nuée de fonctionnaires ignares. Dans les rapports les mieux confectionnés, on trouvait les énormités les plus réjouissantes. L’argent huilait tous les engrenages de la vaste machine ; le gain est un stimulant sérieux, mais insuffisant. Rien de grand ne se fait sans désintéressement. Et l’autocratie n’avait pas de défenseurs désintéressés ». La remarque ne vaut évidemment pas que pour la Russie du début du xxe siècle.
Terrorisme aveugle et terrorisme sélectif. L’autre thème que nous permet d’aborder ce livre est celui de ce que l’on nomme avec beaucoup d’imprécision « le terrorisme », notion désormais applicable, selon les nécessités, à tout groupe armé non étatique, voire à certaines formes radicales de résistance non-violente (les « écoterroristes », entre autres).
De plus, ce terme ne fait pas la distinction entre, d’une part, le terrorisme de masse ou aveugle, destiné à effrayer toute une population, ou qui ne fait aucun cas des victimes collatérales ; et, d’autre part, le terrorisme sélectif ou les « assassinats ciblés » comme on dit curieusement en Israël 9, lequel ne s’en prend qu’à des individus d’une catégorie particulière (religieuse, politique ou sociale) de la population que le groupe armé considère comme ennemie. Relèvent par exemple de la première catégorie les frappes islamistes contre les tours jumelles de New York, ou les attentats-suicides perpétrés par la même mouvance, les explosions commanditées dans les transports ferroviaires italiens par des services secrets occidentaux dans les années 1970, ou les bombardements de populations civiles (Hiroshima, mais aussi Coventry, Dresde, Tokyo, Gaza…).
Relèvent de la seconde catégorie les assassinats ou les « jambisations » perpétrés par des groupes armés italiens contre des politiciens ou des syndicalistes qu’ils jugeaient traîtres ou corrompus, et d’une manière générale toutes les opérations homicides plus ou moins précisément « ciblées » ; comme par exemple les liquidations de militants palestiniens ou islamistes au moyen de drones ou de voitures piégées, en Palestine ou au Pakistan. Dans la Russie tsariste, les attentats ne visaient jamais que les personnalités du régime, les grands propriétaires ou les industriels, quoiqu’il n’était pas rare que des policiers et des cochers soient touchés par les engins des terroristes – qui pouvaient commettre des erreurs. Ainsi les 6 tués et les 37 blessés par la bombe lancée maladroitement par le S.-R. Ivan Frolov contre le commandant de la forteresse de Sébastopol, le 14 mai 1906. Dans son livre, Savinkov affirme avoir toujours voulu « épargner les personnes ne touchant pas directement au pouvoir ». Remarquons que de tels scrupules n’ont pas toujours effleuré les nationalistes de gauche basques ou irlandais dont les victimes se sont recrutées quelques fois parmi les populations qu’ils voulaient défendre, et encore moins les islamistes radicaux. Il est juste, par contre, de remarquer que ces scrupules n’ont jamais fait défaut aux Tupamaros uruguayens ou aux militants d’Action directe en France, par exemple. Les S.-R. acceptaient la pendaison comme une juste réparation de leurs actions assassines, s’ils venaient à survivre à celles-ci. Ainsi, Souliatitski, qui aida Savinkov à fuir la prison de Sébastopol, et qui devait tuer le tsar, voyait en son exécution probable (si l’attentat pouvait avoir lieu) « la rédemption d’un meurtre inévitable et pourtant sacrilège ». Un certain nombre d’entre eux nourrissait même une attirance morbide pour le sacrifice suprême. « La révolution m’a donné le bonheur, qui est plus que la vie, et vous comprenez que ma mort n’est qu’une bien faible expression de ma gratitude envers elle », écrivait le S. R. chrétien Kaliaïev dans sa prison. « J’irai au supplice, le visage serein, un sourire sur les lèvres. Et cela doit vous être une consolation de savoir que j’éprouverai alors un tel bien-être » surenchérissait, dans une lettre à ses proches, Boris Vnorovski, qui blessa le gouverneur de Moscou Doubassov, l’année suivante.
Mais tous ne partageaient pas ce masochisme doloriste, qui échéait préférentiellement aux militants d’origine bourgeoise. Pour l’ouvrier Fiodor Nazarov, qui exécuta le traître Tatarov, les choses étaient plus simples : « Il faut tous les faire sauter », dit-il un jour à Savinkov qui lui demandait les raisons de son engagement. « Ses paroles et ses actes étaient marqués non par l’amour de celui qui est humilié ou affamé, mais par la haine de celui qui humilie, qui affame », commente le chef S. R.