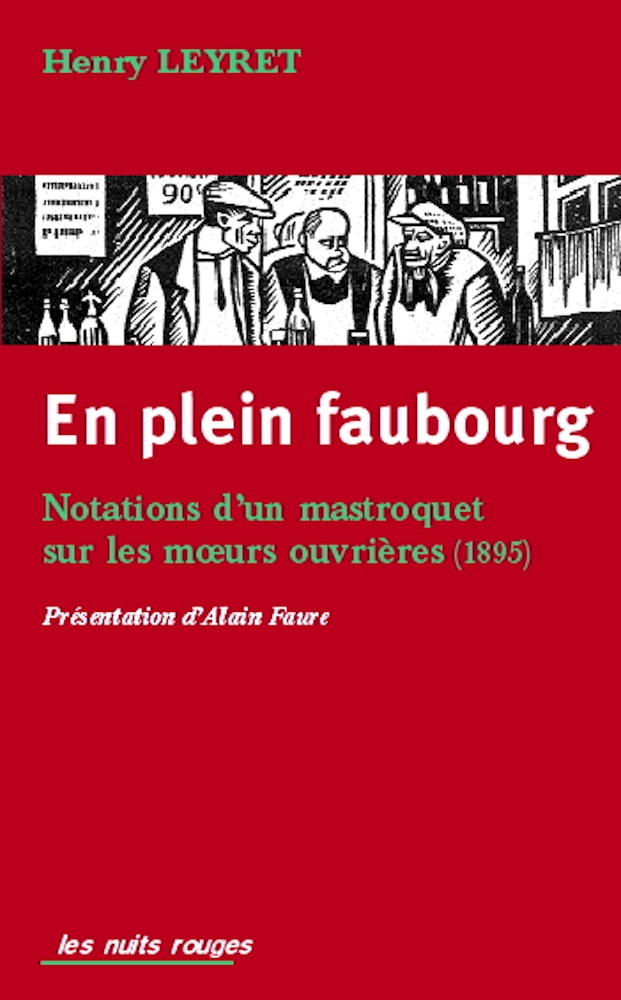En plein faubourg
« Loyal, pas méchant, l’ouvrier parisien est très généreux… Un maçon prend une voiture, se promène pendant une heure et demie, puis, en s’excusant de n’avoir pas davantage, il donne seulement 20 sous au cocher ; celui-ci maugrée, tempête, enfin, bon enfant, finit par accepter ; on prend un verre, on trinque ensemble, l’automédon regagne son siège quand, soudain, l’autre l’insulte : – T’es pas honteux de travailler à vil prix ? 20 sous ! T’as donc pas de cœur, canaille, pour trahir tes frères ? Ahuri, furieux, le cocher lève la main, les deux hommes roulent sur le trottoir, mais c’est le cocher qui est le plus fort, il tient son singulier client sous les genoux, il peut le frapper, l’abîmer, quand, s’arrêtant, il dit : – Tu vois, je pourrais te faire mal, tu le mériterais, car tu t’es salement conduit. Mais je ne t’en veux pas, t’as bu un coup de trop ! Lève-toi et faisons la paix. »
Pour ce reportage dans ce qu’on n’appelait pas encore « les quartiers sensibles », le journaliste Henry Leyret s’était fait bistrottier pendant quelques mois. Ses observations pertinentes, émaillées de « brèves de comptoir » authentiques, constituent un témoignage de première main, précis et souvent drôle, sur la condition et les idées politiques des ouvriers parisiens de la fin du XIXe siècle.
Présentation d’Alain Faure
Prix : 10.20€
Description
Lire un extrait
PrĂ©sentation d’Alain Faure
Avouons-le d’emblée, si En plein faubourg est un texte bien connu des historiens, il n’en est pas de même de son auteur, dont nous ne savons que peu de choses. Henry Leyret, né à Marseille en 1864 et mort quatre-vingt ans plus tard, début mai 1944, on ne sait où précisément, mena une carrière de journaliste politique, écrivant dans les grands journaux de son époque, L’Aurore, Le Figaro, Le Temps… Il ébaucha même un début de carrière politique en entrant, tout jeune, au cabinet de Waldeck-Rousseau, quand celui-ci, en tant que ministre de l’Intérieur, faisait voter la loi sur la liberté syndicale, en mars 1884. Waldeck fut le grand homme de Leyret, qui lui éleva un monument de papier en publiant l’ensemble de ses discours et écrits et en lui rédigeant une biographie. Son dernier ouvrage, De Waldeck-Rousseau à la C.G.T., paru en 1921, oppose l’idéal républicain de l’entente entre le capital et le travail – l’esprit même de la loi de 1884 – à la guerre de classes prônée par un syndicalisme à ses yeux dévoyé. Comme son ancien patron, Leyret aurait sans doute pu se dire « républicain modéré, mais non modérément républicain »…
Cependant il y eut toujours chez lui – du moins dans la première partie de sa vie – un intérêt pour le monde ouvrier et une grande sensibilité aux injustices sociales. Ainsi, en 1900, il publia, en les commentant, les fameux Jugements du président Magnaud, lequel, à Château-Thierry, avait fait remplacer le crucifix de la salle d’audience par des emblèmes républicains et s’était rendu célèbre par ses attendus « justes et humains ». C’est cette fibre sociale qui aussi l’amena à s’intéresser de près aux anarchistes et à leurs idées. Dans En plein faubourg, il reconnaît, sans s’indigner, que les libertaires jouissaient dans le peuple d’un fort capital de sympathie. D’ailleurs, journaliste à L’Aurore – le journal de Clemenceau, où bientôt sera publié le « J’accuse ! » de Zola –, ne mena-t-il pas campagne pour la libération des anarchistes lourdement condamnés, notamment Cyvoct et les mineurs de Montceau-les-Mines, maintenus au bagne en dépit de leur grâce ? D’où aussi cette idée, dans le but d’observer tout son soûl et d’être mieux à même de comprendre la vie et les pensées du peuple, d’ouvrir un bistrot près de Belleville : vraie plongée en pays ouvrier, dont il ramena une brassée d’observations et dont il tira ce livre, paru en 1895. En plein faubourg est de loin son œuvre la plus originale, c’est aussi la seule, nous le disions, qui n’ait pas sombré dans l’oubli : « le Leyret » était déjà bien connu des spécialistes. Cette postérité, sanctionnée par la présente réédition, n’est que justice car il s’agit bien d’un témoignage original, rapporté sans parti pris ni œillères et servi par une grande faculté d’observation. Voyons cela de près.
Leyret a-t-il été inspiré par des modèles ? On songe bien sûr au naturalisme : En plein faubourg continuerait le sillon ouvert par L’Assommoir en 1877. Mais c’est là une fausse piste car, malgré son style alerte, chez lui l’ambition littéraire est absente 1. On verra par ailleurs que le livre fut édité sans soin particulier… Ici, tout simplement, Leyret le journaliste fait œuvre de… journaliste. Dans le métier, on savait bien que pour approcher l’ouvrier une visite dans un débit de boissons s’imposait. Un de ses confrères, auteur en 1886 d’une série d’articles sur « la misère à Paris », donnait la recette : « Il faut aller dans les cabarets […], passer des heures entières, boire avec leurs habitués la verte et le petit bleu, si l’on veut se faire une idée juste des souffrances qu’endurent les ouvriers, des opinions qu’ils professent et des passions qui les tourmentent. Là vous verrez leurs âmes à nu » 2. Le comptoir était aux yeux de l’écrivain en mal de copie un moyen tout trouvé pour pénétrer dans un univers social et mental ressenti fondamentalement comme étranger et étrange. Il y avait toujours dans ces reportages un côté « voyage d’exploration », un relent d’exotisme. Cette représentation des gens du peuple comme de nouveaux barbares campés aux portes de nos villes a inspiré des genres littéraires mineurs comme le pittoresque – Leyret cite un de ses éminents représentants sous le Second Empire, Privat d’Anglemont – ou plus tard le populisme. Et aujourd’hui encore, la façon dont il est parlé des « jeunes des banlieues » – ce genre a un besoin viscéral de clichés –, pourrait faire croire que bien des journalistes ont été formés à l’École coloniale, si celle-ci existait toujours !
Dès lors, quelle est l’originalité du reportage de Leyret ? Le sérieux même de l’entreprise et l’intelligence de l’auteur. Il ne s’est pas contenté d’enfiler un bleu de chauffe et de visser une casquette d’ouvrier sur sa tête pour entreprendre à la hâte une sorte de « micro-comptoir », mais il a pris patente, bricolé une installation, et, cinq mois durant, fait le bistrot, ou – employons le terme usuel de l’époque – le marchand de vin. Cela est attesté par un autre journaliste, Maurice Talmeyr, qui fait allusion, en 1901, à « un homme de lettres » ayant acheté quelques années auparavant un débit faubourg du Temple « pour nous donner un livre vécu », précisément : En plein faubourg…… Cette mise en scène, sorte d’observation participante, même ainsi limitée dans le temps, permit à Leyret de bien voir et de mieux comprendre, tordant le cou au passage à quelques préjugés. C’est cette expérience un peu hors du commun du monde des journalistes qui lui fait écrire cette phrase que devraient méditer aussi bien les historiens à l’affût d’une parole populaire vraie que ses modernes confrères : l’ouvrier est « très méfiant envers qui l’interroge, parce qu’il se suppose, pour qui n’est pas des siens, un objet de répulsion ou d’exploitation, il élude toute question trop directe, évitant d’y répondre autrement que par des échappatoires ». La parole n’est alors qu’une fumée protectrice. Nous parlions de préjugés corrigés par l’observation… L’alcoolisme est le premier d’entre eux. L’ouvrier ne boit pas tant que cela, répète Leyret, et s’il fréquente à ce point le marchand de vin, ce n’est pas « dans le but de se griser », mais d’abord pour délasser son corps et son âme des contraintes extérieures, du travail et de la discipline. Les samedis de paye, c’est vrai, il y a un peu de viande saoule dans le faubourg, mais n’exagérons rien, ajoute-t-il, c’est « l’ivresse du chant plus que l’ivresse du vin » qui fait tituber celui qui se paye cette escapade dans les vignes du Seigneur. Mais alors que deviennent Zola, l’Assommoir, Coupeau et sa crise de delirium tremens… ? De purs et simples calomnies, si l’on en croit les clients de Leyret qui nous rapporte leurs propos, témoignage infiniment précieux sur la réception dans le peuple d’une littérature censée peindre la réalité populaire… L’Assommoir fut reçu comme une insulte dans le faubourg, d’autres témoignages le disent. D’ailleurs, le marchand de vin n’était pas seulement ce cercle de quartier, cette sorte de salon que nous décrit Leyret, il avait dans la vie ouvrière bien d’autres fonctions : c’était, le midi, la seule « cantine » abordable pour les ouvriers habitant loin ; il pouvait à l’occasion jouer le rôle d’intermédiaire pour le placement – mais on devine les dérives ; mais surtout il offrait un lieu commode pour les réunions politiques et syndicales : les associations de toute nature qui avaient leur siège au bistrot étaient légion 4. Le nombre considérable des débits de boisson à Paris – 25 000 en 1895, lorsque paraît En plein faubourg, contre moins de la moitié aujourd’hui… – était à la mesure non pas de la soif extrême des Parisiens, mais de l’intense sociabilité dont ces lieux étaient l’instrument.
Bien des valeurs et des comportements ayant cours dans le peuple ont été précieusement consignés par notre mastroquet ethnographe. Retenons parmi les traits saillants de ce portrait mental du prolétaire parisien l’indignité du crédit – recourir au crédit, c’était ne pas « faire face à ses affaires », c’était avouer sa misère – ; le désir, sans nul état d’âme, de s’établir « à son compte », comme petit patron ; une certaine joie de vivre aussi, en dépit de tout ; le goût de la bagarre – à ne pas confondre, dit Leyret, avec la violence : la paix est toujours offerte à l’adversaire dès qu’il a le dessous – ; ou encore la recherche de l’image et de la formule : le peuple a toujours habité le langage comme une maison à lui. Et n’oublions pas cet attrait pour le chant, qui semble avoir beaucoup surpris Leyret, ou plus précisément pour la société chantante, comme au beau temps des goguettes. Sur le plan de la condition matérielle, tout ce que dit l’auteur est juste, malheureusement : la morte-saison annuelle était la plaie de bien des professions encore, réduisant souvent à peu de choses un salaire nominal déjà bas – et que dire des salaires féminins ! –, et surtout à cette époque où quasiment toute la protection sociale moderne restait à mettre en place, rien n’était jamais acquis à celui qui avait le malheur d’être ouvrier : un accident, une maladie, un chômage un peu long, et l’existence apparemment la mieux assise pouvait tourner au drame.
Mais il arrive aussi que le portrait se brouille, et Leyret nous tend parfois de ses ouvriers de clients des images contradictoires. Ces bouffeurs de curés et pourfendeurs de généraux ont beau annoncer le « grand soir » tous les quatre matins, ce sont en fait, dit-il en substance, des résignés dans l’âme, point si mécréants que cela et en réalité attachés à la patrie. Mais quelques pages plus loin, il a cette formule : « Le vrai faubourien ne fuit jamais l’odeur de la poudre », et surtout ne raconte-t-il pas lui-même que lors d’un réveillon dans son débit la nuit entière se passa à chanter tout le répertoire révolutionnaire de l’époque ? On touche là aux pensées profondes et aux aspirations réelles des prolétaires : cinq mois étaient sans doute un temps trop court pour percer l’apparent mystère de ces contradictions… Et pour une telle entreprise, il aurait fallu sortir du bistrot et suivre l’ouvrier chez lui, ainsi que dans ses autres cercles, le syndicat, le quartier, la famille…
Donc, ne sollicitons pas trop « le Leyret », d’autant que son livre pèche par quelques lacunes et erreurs d’observation. La femme, sans être absente de ses analyses, est essentiellement vue par lui comme l’épouse et la mère. Et ce n’était pas faute de la croiser dans son débit : les sociétés chantantes du samedi soir étaient bel et bien mixtes, il le dit formellement. Leyret reproduit d’autre part les arguments ouvriers contre le travail des femmes, sans commentaires il est vrai, mais on sent bien qu’il y applaudissait. Sur les erreurs, voici peut-être la plus symptomatique. Il parle de l’amour des familles ouvrières pour leurs enfants, et rien n’est plus juste. Les petits d’ouvriers partaient peu en nourrice, et ce n’était pas seulement une question d’argent. Mais là où il se trompe, c’est quand il associe cet amour au nombre des enfants. Depuis une bonne quinzaine d’années, les couples ouvriers à Paris limitaient leurs naissances, recherche d’un mieux-être, qui n’avait rien à voir avec un dégoût de l’enfant : l’enfant est d’autant plus chéri qu’il est rare. Pour Leyret, c’était là de l’égoïsme pur, avec avortement criminel à la clef. Pas de pitié pour les « faiseuses d’anges » ! Il fait preuve d’un égal moralisme dans ses considérations sur l’éducation des enfants, devant qui il ne faudrait pas prononcer de « gros mots », ou encore dans sa condamnation de l’homosexualité. Mais que le lecteur se rassure. Il apprendra beaucoup, dans cet ouvrage souvent plaisant, parfois amusant, sur ces ouvriers parisiens un peu mythiques d’entre la Commune et la Grande Guerre. Il passera rapidement sur certaines tirades au style daté, engluées dans des débats d’époque, qui n’intéresseront que les spécialistes, pour réfléchir, à son tour, sur la nécessaire critique des témoignages, qui passe par une révision permanente des clichés et des savoirs établis. Des images faisons table rase !
Alain FAURE
NOTESÂ :
1. Il est vrai qu’il avait publié l’année suivante un roman intitulé Pourquoi aimer ?, mais sa carrière d’écrivain s’est arrêtée là .
2. Marcel Édant, « La misère à Paris. XII. Belleville », in Le Gagne-Petit, 14 mai 1886.
3. M. Talmeyr, « Le marchand de vin » dans La Cité du sang, 1901, p. 146.
4. Voir à ce sujet l’excellente étude de Nathalie Graveleau, Les cafés comme lieux de sociabilité politique à Paris et en banlieue 1905-1913. FEN, Cahiers du Centre fédéral, 1992, 254 p.