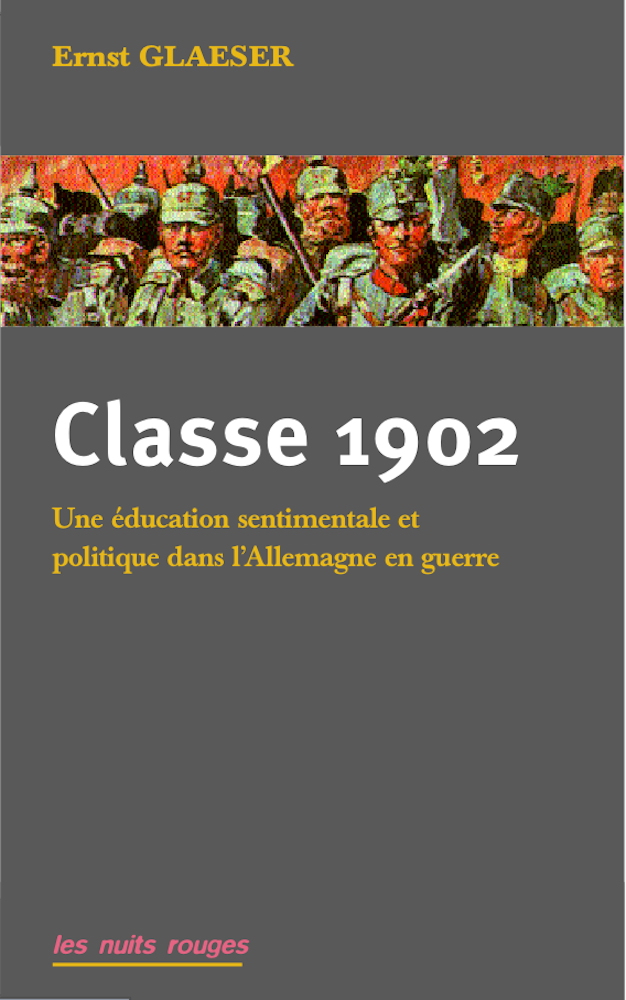Classe 1902
Ce premier grand témoignage sur la guerre de 1914-18 côté allemand connut un succès mondial lorsqu’il parut en 1928, un an avant A l’Ouest, rien de nouveau. En bonne partie autobiographique, il a pour cadre une petite ville du sud de l’Allemagne, d’où se fait parfois entendre la canonnade de Verdun. On a souvent présenté Glaeser comme un écrivain politique. Toutefois, le fait d’avoir été proche à la fin des années 1920 du Parti communiste n’influa que partiellement sur son œuvre romanesque. Ce récit est d’abord la chronique d’une adolescence dont il ne cache rien, alternant émotion, sensualité, et humour aussi. Mais on verra que les tableaux qu’il brosse par ailleurs de «l’union sacrée» ou de l’antisémitisme ordinaire en sont d’autant plus convaincants.
Ernst Glaeser (1902-1963) est aussi l’auteur du Dernier Civil (rééd. 1986) et de La Paix (rééd. 1974), ce récit de la révolution de 1918 dont Classe 1902 constitue la première partie.
Traduit de l’allemand par Joseph Delage & Cécile Knœrtzer (1929).
Prix : 11.30€
Description
Lire un extrait
A une large table, près de l’orchestre de droite, étaient assis le mécanicien Kremmelbein et un grand nombre de ses camarades. Ils avaient tous des nœuds noir, blanc, rouge à la boutonnière, où j’avais vu autrefois un œillet rouge. Auguste me montra une chaise et alla me chercher un verre de bière. Comme il le posait devant moi, le mécanicien frappa du poing sur la table en s’écriant :
— Camarades, on attaque l’Allemagne, cela ne fait pas de doute. Ce n’est pas à moi, vous savez, qu’on bourre le crâne. Eh bien ! il faut que nous défendions la patrie !
— D’accord ! crièrent les camarades en levant leurs verres de bière.
Et Kremmelbein continua :
— Scientifiquement la chose se présente ainsi : si maintenant les classes dirigeantes ont besoin de nous, les ouvriers, pour repousser l’agression ennemie, qui est aussi dirigée contre nous, nous ne le ferons naturellement pas pour rien !
— D’accord, dirent encore les camarades en levant leurs verres.
— Je crois que nous pourrons, si l’Allemagne est victorieuse, poser quelques conditions : journée de huit heures, liberté de vote et droit de grève.
— Hourrah ! crièrent les camarades en levant leurs verres pour la troisième fois.
— Pour nous, la guerre est une excellente affaire. La bourgeoisie a besoin de nous, nous lui présenterons le compte à régler.
Les camarades grimacèrent un sourire.
— Et n’oublions pas qu’en France, ils ont assassiné le camarade Jaurès. Nous, socialistes, nous avons le devoir de le venger. Voilà pourquoi il faut la guerre !
— A bas la France ! ! ! crièrent les camarades, et leur cri se prolongea et fut repris par les bourgeois.
Alors Kremmelbein sauta sur la table et cria :
— Chaque ouvrier allemand combattra pour la sécurité de sa patrie ; il versera pour elle jusqu’à la dernière goutte de son sang. Peuple allemand ! tu verras qu’à l’heure du danger, les plus pauvres de tes fils sont aussi les plus fidèles.
Sous la tente ce fut du délire. Les deux orchestres firent retentir un ban en l’honneur de Kremmelbein. A toutes les tables des gens se levaient qui criaient :
— Vive Kremmelbein, vive !
Et tandis que leurs acclamations se perdaient dans le chant du Deutschland, Deutschland über alles (l’Allemagne avant tout !), Persius, qui portait déjà l’uniforme, s’approcha de notre table et donna la main à Kremmelbein :
— Oublions tout, lui dit-il, soyons unis. A l’heure du danger, les partis n’existent plus !
Kremmelbein sourit et prit la main de Persius :
— Chacun a ses opinions, monsieur le docteur. Autrefois vous aviez pour vous la police ; mais maintenant que la patrie est en danger, nous oublierons tout. Quand la paix sera rétablie, nous pourrons peut-être reparler de nos affaires.
— Oui, dit Persius tout en prenant involontairement une attitude militaire, quand nous aurons la victoire…
Et ils se secouèrent la main. L’orchestre donna encore le signal d’un ban. On entoura Kremmelbein et Persius, et tandis que spontanément la foule entonnait la Wacht am Rhein, Persius cria à la serveuse bavaroise :
— Toute la bière qu’on consommera à cette table, c’est ma tournée !
Au même instant le docteur Hoffmann et Brosius se précipitaient dans la tente en gesticulant. Mon père s’était placé derrière moi et avait commandé un plat de grillades pour Kremmelbein et ses compagnons. Un trompette fit entendre une sonnerie militaire. Alors Hoffmann gravit les degrés de la tribune en brandissant sa canne, Brosius à ses côtés. Hoffmann avait à la main une feuille de journal, édition spéciale.
— Silence ! cria-t-il.
Puis, il ajouta, après une pause savante, et d’une voix aussi douce que s’il avait récité une prière :
— La France vient de nous déclarer la guerre !
— Hourrah ! hurlèrent toutes les gorges.
On levait les bras au ciel ; on montait sur les chaises, comme si de là on avait pu mieux voir l’avenir.
Mon père me tapa sur l’épaule en riant. Deux tireurs déchargèrent leurs fusils. Plusieurs personnes s’embrassèrent. Kremmelbein bondit encore une fois sur la table pour crier :
— Vengeons Jaurès ! tandis que ses compagnons reprenaient son cri et que le nom de Jaurès résonnait sous la tente comme si on eût fêté un héros national allemand.
Et, à la tribune, le docteur Hoffmann et Brosius se serraient la main.
— Compatriotes et camarades, criait Hoffmann, oublions, à l’heure du danger, toutes nos mesquines dissensions. Donnons-nous la main : ouvriers et bourgeois, paysans et ouvriers. Faisons entre nous le même serment que notre empereur, qui a voulu la paix jusqu’au dernier moment, et n’a tiré l’épée que parce qu’on l’y forçait, parce qu’on nous attaquait ; jurons de réaliser l’union sacrée. Plus de partis ! rien que des Allemands !
Une forêt de mains se tendit vers lui pour ce serment et je levai aussi la mienne.
Et les mots « Je jure » résonnèrent pesamment sous la tente comme s’ils étaient sortis de la bouche d’un géant, car tous les avaient prononcées d’une seule voix. L’individu n’existait plus. Que le monde en cet instant me parut donc solennel !…
* *
Et les mains restèrent levées aussi longtemps que l’orchestre joua la première partie de l’Action de grâces des Hollandais. Ce n’est que lorsque le second orchestre attaqua bruyamment l’hymne allemand, que nous saisîmes nos verres de bière pour les lever bien haut, en riant et en chantant. Arrivés au troisième verset que presque personne ne savait par cœur, Brosius s’écria :
— Silence ! Vive s. m. l’empereur, le prince de la paix et notre chef suprême. Vive ! vive l’empereur !
— Cul sec ! ordonna Brosius, et tout le monde porta les verres aux lèvres et en vida le contenu d’un seul coup.
J’avalai de travers ; une partie du liquide coula par le gilet de mon costume marin jusqu’à mes caleçons.
Alors Brosius mit son bras sur l’épaule de Hoffmann et descendit lentement avec lui les marches de la tribune. On les couvrit d’ovations. De vigoureux garçons apportèrent cinq nouveaux tonneaux de bière qu’ils mirent aussitôt en perce.
Je glissais lentement de ma chaise. J’avais la tête comme entourée d’ouate. Auguste était à côté de moi, mais sa voix me semblait venir de très loin. Je regardais avec lassitude sous mes paupières mi-closes. Au buffet, Kremmelbein et Persius trinquaient ensemble ! Mon père s’était aussi, lui, adjoint un compagnon à qui il payait à boire et à manger.
La bière m’avait laissé un goût âcre dans la bouche. Il me semblait parfois que les tables valsaient et que les hommes assis autour se levaient et s’abaissaient comme des bouchons sur une eau agitée. A côté de moi, Auguste disait :
— Maintenant, tous les hommes sont égaux. Il n’y a plus de différence entre eux.
Je bégayais « oui », tout en faisant de vains efforts pour distinguer un visage.
— Moi non plus, fis-je, je ne vois plus de différence…
Tout tournait ; les figures s’effaçaient.
Lentement je tombai en arrière… Ce n’était pas seulement l’effet de la bière… Ma mère alla me chercher du café et se mit à rire parce que je m’embrouillais en parlant. Et les gens assis autour de la table riaient aussi. Auguste me soutenait ; le café me réveilla. Tout à coup, je reconnus Brosius ; il se tenait devant moi, fier comme un potentat, mais le sourire aux lèvres. Il posa sa main sur mon épaule. C’est la première fois que je le voyais sourire et qu’il se montrait si condescendant.
— Eh bien ! dit-il, depuis quand un jeune citoyen allemand ne supporte-t-il pas un verre de bière ?
Je me levai d’un bond, je vacillais, mais quand mon regard rencontra le sien, je me raidis et m’écriai :
— A vos ordres, monsieur le docteur Brosius.
— Bravo ! me dit-il, et je le vis s’en aller. Je retombai, tout heureux sur ma chaise. C’était la première fois que mon maître me félicitait.
Devant moi je voyais ce monde des grandes personnes, dont la haine et la méchanceté m’avaient tant troublé autrefois, dont le secret m’avait poussé au parjure, au vol, à la première terreur mortelle de ma vie et m’avait arraché le serment de ne jamais devenir une grande personne. Ce monde d’angoisse se présentait maintenant à moi sous un jour tout à fait nouveau. Partout où se posaient mes regards les hommes s’embrassaient. Tous se voulaient du bien comme autrefois ils s’étaient voulu du mal. Persius et Kremmelbein, Brosius et Hoffmann ne se haïssaient plus. Ils buvaient et chantaient ensemble, et leurs yeux brillaient du même éclat. Le monde était comme rajeuni… la guerre l’avait rendu bon…
— Ah ! maman, bégayai-je en lui tombant dans les bras dans un véritable état de béatitude, comme la guerre est belle !…
Elle m’entraîna alors avec Auguste, hors de la tente. En me retournant, je vis encore à travers la fumée qui enveloppait tout ce monde en délire, Brosius et Hoffmann qui trinquaient ensemble comme de vieux amis.
Lorsque je fus à l’air, je chancelai. Auguste me soutint. En passant devant un Panoplikum, qu’éclairaient des lumières bleues, rouges et vertes, et qui représentait des scènes de la Guerre de libération *, nous entonnâmes le chant : «Nous prions devant toi, Dieu juste…» au milieu de toutes les bruyantes manifestations patriotiques de cette nuit de fête. C’était le 2 août, la première fois que j’étais gris.