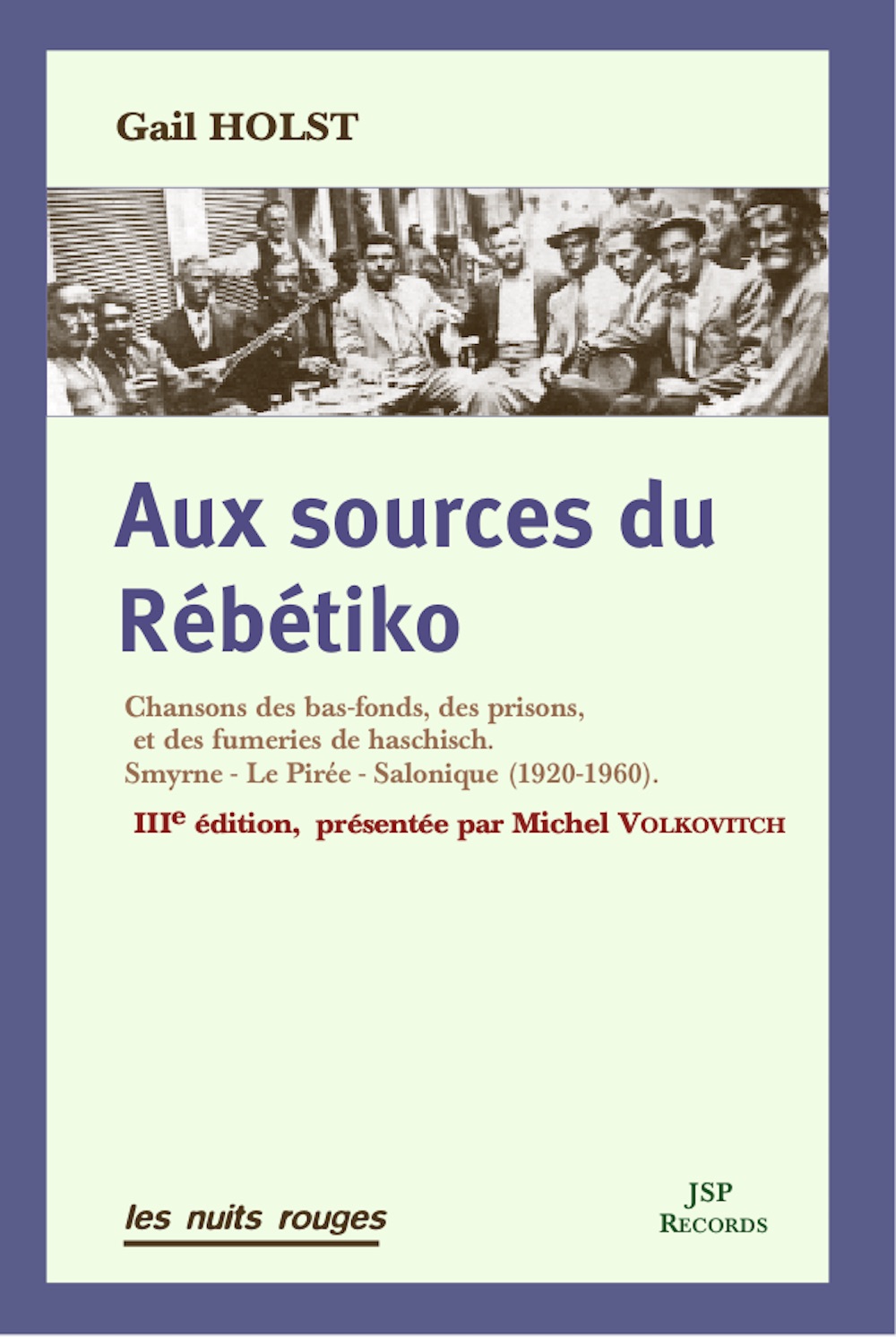Aux Sources du Rébétiko
Les touristes qui visitent la Grèce ne connaissent guère le rébétiko, musique urbaine importée de Turquie dans les années 1920, qu’on qualifie parfois de « blues grec », et qui se survit aujourd’hui dans quelques bonnes tavernes, après avoir influencé les compositeurs Hadjidakis et Théodorakis, et des chanteurs comme Nikos Papazoglou, Haris Alexiou, Maryo ou Dalaras. Gail Holst, Australienne de naissance, mais Grecque de cœur, a parcouru les bas quartiers et les campagnes de Grèce dans les années 1970, rencontrant chanteurs et amateurs de rébétiko. Elle en a tiré ce livre, abondamment illustré de photos et traduit en plusieurs langues. Son travail musicologique lui a valu la reconnaissance de plusieurs musiciens dont Mikis Theodorakis, qu’elle a d’ailleurs accompagné au clavecin à une époque. Elle enseigne aujourd’hui à l’université Cornell aux Etats-Unis, mais ne dédaigne pas de pousser la chansonnette rébétique quand l’occasion se présente. Cette réédition reprend celle de 2010, mais y ajoute un avant-propos inédit de Michel Volkovitch. Le choix des chansons qui accompagnent le livre privilégie les enregistrements originaux de la grande époque du rébétiko. Il n’y aura pas de CD joint, mais on pourra écouter les chansons sur ce site.
Prix : 9.00€
Description
Lire un extrait
3/ Le Pirée dans les années 1920 – Début du voyage
Si vous débarquez aujourd’hui d’un bateau au Pirée, et que vous dirigez vers la station de métro voisine, vous passerez devant un gros socle en béton surmonté d’une statue de Karaïskakis, un héros de la Guerre d’indépendance. Vous ne pouvez pas le rater sur son cheval dressé sur les pattes arrière et avec sa fine moustache. Mais si vous aviez suivi le même chemin vers 1929, vous auriez trouvé en lieu et place du square et de sa statue, un dédale de petites rues et d’échoppes. Dans l’une d’elles, vous auriez pu déguster une tasse d’un velouté café turc et demander une pipe à eau, ou narguilé, que le tenancier aurait retiré précautionneusement d’une étagère avant de l’allumer à l’aide de quelques charbons incandescents. Des hommes aux moustaches soigneusement taillées y prendraient leurs aises sur des sièges tressés de jonc, jouant avec leurs chapelets d’ambre (komboloï) et échangeant quelques considérations sur la difficulté de trouver un boulot – à moins que, pris par la nostalgie, ils n’aient préféré évoquer leurs maisons et leurs terres perdues de Turquie.
De l’une des boutiques voisines vous parviendrait le son affaibli d’une musique. Vous auriez alors pu questionner Nikos Mathésis (alias Nikos le Fou) ou Marinos la Moustache, qui, pour toute réponse, vous auraient alors guidé vers le téké voisin pour écouter Batis divertir ses amis avec son minuscule baglama. Vous y auriez découvert des mangkès assis sur le sol autour d’un feu de bois et un garçon occupé à bourrer les narguilés de haschisch avant de les passer à la ronde. Batis aurait commencé par improviser un taximi selon le mode rast, avant d’entamer un morceau de sa propre composition, ou, à défaut, de Papazoglou, dit le Concombre. Mais, à moins que vous n’ayez été vous-même un mangkas, vous n’auriez pas compris facilement toutes les paroles des chansons, écrites principalement en argot :
« Là-bas, vers Lemonadika, les flics ont attrapé une paire de voleurs de choux (pickpockets). Ils leur ont mis les fers (les menottes) et les ont emmenés dans le réduit (la prison), et s’ils ne retrouvent pas le chou (le portefeuille), ils vont leur faire bouffer du bois (les tabasser)…»
Pendant ce temps, un des mangkès, déjà bien « défoncé », aurait commencé à danser lentement. Pendant qu’il tournerait sur lui-même en tanguant, que les autres fumeraient et chanteraient, Batis tirerait de son instrument quelques douces notes tristes, permettant à tous d’oublier un moment la vie âpre du Pirée de ces années-là.
* *
Bien que quelques disques d’inspiration proche aient été fabriqués hors de Grèce, en Amérique ou en Turquie, et ce dès 1915, Le Pirée fut le berceau du rébétiko enregistré, le seul que nous puissions étudier vraiment. Car, en effet, si ses racines plongent dans le XIXe siècle, nous ne pouvons connaître précisément les formes qu’il pouvait revêtir, vu son mode de transmission oral.
Une chose sûre : c’est à cette époque qu’apparaissent des tavernes musicales à Athènes et au Pirée, ainsi qu’à Larissa, Hermoupolis (dans l’île de Syros), Thessalonique (sous domination turque jusqu’en 1913), Smyrne (Izmir) et Constantinople. Ces débits revêtaient des formes assez diverses, mais le plus typique était le café-aman, probablement une déformation tsigane du mani kahvesi turc, où deux ou trois chanteurs improvisaient des vers de mirliton, souvent sous forme de dialogue et sur fond de rythmes ou de mélodies également improvisés. Comme ils lâchaient à tout propos les mots Aman, Aman ! (« Pitié ! » ou « Hélas ») pour se donner le temps d’inventer de nouvelles paroles, on qualifia bientôt ces chants d’amanés. Une des toutes premières formes du rébétiko est justement l’amané, chanson à demi-improvisée dans laquelle les vers sont parsemés de longs mélismes* sur le mot aman. Kostas Roukounas, un auteur-compositeur qui s’illustra dans plusieurs styles – démotique, café-aman et rébétiko – a produit un grand nombre d’amanés. Avec le temps, le style du Pirée, avec ses bouzoukis, est devenu plus populaire que l’amané. Les longs passages mélismatiques furent laissés à l’inspiration de l’instrumentiste et le mot aman n’apparut plus que sous la forme d’une brève interjection rituelle.
Dans les premiers cafés-aman, il y avait toujours un coin réservé aux musiciens de passage, souvent des Tsiganes qui entraient un moment pour jouer un morceau, avant de passer à un autre établissement. Plus tard, des petits orchestres, appelés kompanias, furent engagés à l’année. Ils mêlaient des instruments grecs et turcs, tels le santouri (cithare incroyablement complexe, faite de soixante-douze cordes que l’on frappe à l’aide de petites baguettes en bois), la flûte, le violon, le laouto (une sorte de luth) et l’outi (dérivation grecque de l’arabe oud) (voir p. 54). Des duos de femmes se produisaient fréquemment dans les cafés-aman : l’une interprétant des chansons de style turc, l’autre dansant. Selon les habitudes des Roms de Turquie, elles utilisaient des petites cymbales et des tambourins pour souligner le rythme du morceau. La danse la plus fréquente était le tsiftétéli, exécutée sur un rythme de danse du ventre, et tout aussi provocante. Mais il y avait aussi la casaska, une imitation de danse cosaque ; l’allegro, de style slave aussi ; et le zeïbékiko, qui deviendra la danse la plus souvent associée au rébétiko.
Si l’apport du café-aman fut important dans la genèse du rébétiko « classique », celui des chansons de prisonniers ne le fut pas moins. Depuis la Guerre d’indépendance, la situation politique de la Grèce était instable, pour le moins. Dans ses Mémoires désenchantées, le général Makriyiannis – un héros de cette guerre, qui mourut dans la misère après avoir été emprisonné et humilié – dénonce l’atmosphère de corruption, de répression et de violence dans laquelle baignait le nouveau régime. Atmosphère qui, depuis, fut une constante de la vie politique grecque jusqu’à la chute des colonels. Depuis le couronnement du premier roi, Othon de Bavière, en 1832, les prisons ont toujours été pleines. Les détenus, politiques ou de droit commun, y composaient des chansons et même y fabriquaient des instruments, particulièrement des baglamas , que leur petite taille permettait de dissimuler commodément. A partir d’une petite calebasse utilisée comme caisse de résonance, il suffisait de récupérer un morceau de bois pour le manche, du fil de fer pour les cordes, un bout de boyau, et le tour était joué.
Les chansons composées en prison continuaient tout naturellement à être chantées à l’extérieur par les anciens détenus. Et malgré qu’elles-mêmes et leurs instruments habituels – le baglama et le bouzouki – étaient interdits à une certaine époque, cette musique acquit bientôt ses lettres de noblesse dans les faubourgs des grandes villes. Depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le Milieu représentait une réalité sociale plus vaste que celle d’aujourd’hui, se confondant avec le sous-prolétariat. Dans une société corrompue et répressive, où les policiers acceptaient assez couramment des pots-de-vin, et où les candidats employaient des agents pour acheter les votes, s’opposer à la loi était une conséquence inévitable, quasi nécessaire de la pauvreté.
On employait toute une terminologie pour décrire ces franges d’hommes établis aux marges de la société – les koutsavakithes, les mangkès, les rébétès, les vlamithes, les tsiftes. On découvre dans les œuvres des écrivains de cette époque, tels Alexandre Papadiamandis et Andréas Karkavitsas, aussi bien que dans les chants rébétiques, de nombreuses références à ces groupes. Leur persécution, notamment celle des koutsavakithes, qui semblent avoir été particulièrement pittoresques avec leurs costumes provocateurs et excentriques – le must était de porter une veste avec une manche flottante –, s’aggrava sous le célèbre Baraktaris, un chef de la police d’Athènes haï de ses contemporains. La mondaine place Kolonaki d’aujourd’hui était alors le lieu habituel de rencontre de ces jeunes fanfarons qui mettaient un point d’honneur à ne s’exprimer que dans un argot très privé.
Une des coutumes de ces micro-sociétés, ainsi que des prisons, était la consommation du haschisch. Dans les villes turques, cette substance était légale et d’usage courant. Mais en Grèce, des lois interdisant sa consommation et son commerce furent promulguées en 1890, quoique non strictement appliquées pendant au moins une trentaine d’années : les autorités toléraient les tékés où, comme nous l’avons vu, il s’en fumait beaucoup. Dans les quartiers de Troumba au Pirée et de Barra à Thessalonique, certains tékés avaient d’ailleurs une telle réputation que les rébétès les évoquaient parfois dans leurs chansons : ainsi le téké Sidheris de Thessalonique est-il mentionné dans Throsula (« Le matin, à la rosée »), de Tsitsanis (voir les paroles, p. 131). La musique qu’on y jouait relevait déjà, au tournant du siècle, d’une forme de rébétiko, tout comme les thèmes des morceaux : la prison, l’illégalité, le haschisch…
A la même époque, deux personnages éminemment rébétiques furent intégrés dans le traditionnel théâtre d’ombres, commun à la Grèce et à la Turquie, le populaire kharaghiozi, qui a toujours été un reflet des courants qui agitaient la vie sociale et politique. Stavrakis, le mangkas, et Nondas, le jeune ouvrier, apparurent pour la première fois vers 1905. Tout était donc prêt pour l’émergence de ce nouveau genre musical dès la première décennie du xxe siècle, mais ce fut un événement tout à fait inattendu qui le fit s’épanouir et se concentrer au Pirée.
L’histoire de la Grèce moderne a été longtemps dominée par le thème de « la Grande Idée », c’est-à-dire la reconquête du centre historique de l’Eglise orthodoxe et de la civilisation byzantine, Constantinople. Depuis sa chute en 1453, « la Ville » n’a cessé de bercer les rêves nostalgiques des Grecs. « Le Massacre de Smyrne » fut la conséquence directe de ce rêve grandiose, impossible. Le déroulement de la guerre gréco-turque, en 1921-22, est bien connu.
S’estimant encouragé par ses alliés, particulièrement le gouvernement anglais dirigé par Lloyd George, le cabinet grec donna son feu vert à l’armée afin de lancer une offensive vers l’arrière-pays turc à partir de l’enclave de Smyrne, confiée à l’administration d’Athènes par le traité de Sèvres (1920). Au début, les troupes helléniques ne rencontrèrent presque aucune résistance et parvinrent presque aux portes d’Ankara, bien au-delà de ce qui avait été attribué à la Grèce par le traité. Mais, après plusieurs mois de confrontations, où les envahisseurs ne parvinrent pas à forcer la décision, les forces adverses commandées par Mustapha Kemal lancèrent une offensive fulgurante en août 1922. Les Grecs comprirent alors qu’ils s’étaient isolés de leurs bases et tentèrent de battre en retraite. Mais, effectuée sans aucune protection ni ravitaillement suffisant, celle-ci se transforma en déroute. Une multitude de colons grecs, craignant les représailles turques, abandonna ses fermes et se joignit aux soldats en guenilles. Tous convergèrent vers le port bientôt surpeuplé de Smyrne. Dans la confusion, un incendie se déclara qui fit des milliers de victimes. Beaucoup périrent dans les flammes, mais d’autres se noyèrent en voulant gagner des navires occidentaux, dont les équipages, par souci de ne pas indisposer les Turcs, refusèrent de secourir les fuyards.
Cette guerre déclenchée pour des motifs futiles se conclut par une conférence internationale, où il fut décidé que le conflit se réglerait par un échange de populations entre les deux Etats, comme on l’avait fait pour la Crète, redevenue grecque avec Salonique en 1913. Le critère de nationalité retenu fut la religion : si on était orthodoxe, on était forcément grec, et inversement pour les musulmans qui étaient d’office réputés turcs, y compris ceux qui n’avaient jamais entendu un mot de turc de leur vie. Les réfugiés « grecs », y compris parmi eux des Arméniens et des Juifs, dépassèrent le million. Beaucoup d’entre eux vivaient en Turquie depuis des générations, parlaient couramment le turc et ne se distinguaient qu’en peu des choses des Turcs musulmans.
Dès avant ce qu’on appellera plus tard « la Grande Catastrophe », on avait assisté à une première vague d’immigration. Mais après 1922, ce fut un déferlement de réfugiés venus de toutes les régions de Turquie où vivaient des Grecs, démunis de tout. L’accroissement subséquent de la population de la Grèce, de 25 % au moins, ne manqua pas de créer de graves problèmes à un pays aussi petit et sous-développé. On tenta d’en établir quelques-uns dans les campagnes mais la majorité alla s’entasser dans les grandes villes, et d’abord à Athènes et au Pirée, où, bien que le développement industriel était bien moindre qu’en Europe, quelques possibilités d’emploi se présentaient.
Ces réfugiés avaient amené avec eux les savoir-faire et les coutumes d’une société sophistiquée, mais la plupart ne purent utiliser leurs talents que bien des années plus tard. « On a vécu comme des chiens pendant six mois, racontait Yorgos Rovertakis (il avait alors 12 ans ; son père était maquignon à Smyrne), avant que le gouvernement ne se décide à nous faire construire des baraques… »
C’est ainsi qu’une ceinture de bidonvilles s’édifia tout autour d’Athènes ; certains portaient des appellations ironiques, empreintes de nostalgie, telles que la Nouvelle Ionie ou la Nouvelle Smyrne. La musique de ces réfugiés était très proche de celle qui s’était déjà assuré quelque popularité dans les cafés-aman. Le style émotionnel, un peu ampoulé, appelé « de Smyrne », fut à l’origine d’une efflorescence de nouveaux établissements. Le plus fameux d’entre eux, le Microasia, sur l’avenue du Pirée, à Athènes, devint le siège du premier groupement musical de Grèce : l’Association des musiciens athéniens et piréïotes, fondée par le natif de Thessalonique Manolis Chrissafakis.
Bien entendu, les réfugiés n’appartenaient pas tous au Milieu, mais ils faisaient partie de ces classes défavorisées qui devaient se battre pour trouver du travail, et se trouvaient de plus en butte aux discriminations de la majorité de la population, du fait de leur langage un peu particulier et de leurs habitudes. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup d’entre eux se soient découvert des affinités avec la culture des rébétès et des mangkès, ne serait-ce que par leur goût commun pour le haschisch. A l’inverse, il n’est pas étonnant non plus que les musiciens du rébétiko se soient intéressés aux techniques et à la virtuosité de leurs confrères de Smyrne. Les noms de réfugiés tels que Iovan Tsaous (originaire du Pont-Euxin), Dragatsanis, Marinos, Skarvelis, ou Dalgas, feront bientôt les belles nuits de la scène athénienne et intégreront dans leur spectacle des chansons de la vie des faubourgs, quelquefois sous les appellations de « rébétiko d’Asie Mineure » ou plus simplement smyrnéïko. Dans ce genre, s’illustreront trois chanteuses qui deviendront des stars : Marika Politissa, Rita Abadzi et surtout Roza Eskanazi.
Même si l’amané n’exprimait pas exactement les sentiments du milieu rébétique, constitué, nous l’avons dit, par les prisonniers et les fumeurs de haschisch, les deux styles se sont influencés réciproquement. Les rébétikos étaient souvent interprétés dans les cafés-aman tandis que de leur côté les rythmes et les voix des chanteuses de Smyrne se faisaient une place dans bon nombre de rébétikos. Certains réfugiés s’intégrèrent complètement dans l’univers des mangkès et s’essayèrent à composer des morceaux dans ce style. Toutefois, des musiciens comme Rovertakis et Roukounas n’ont jamais fumé de haschisch de leur vie et auraient été incapables de dire à quoi ressemblait l’intérieur d’un téké. Jusqu’à quel point cette influence se fit sentir est difficile à dire mais c’est un fait que dix ans après leur arrivée en Grèce, le rébétiko avait quitté l’univers confiné des tékés et s’était acquis un début de célébrité dans les villes. Les morceaux qui s’étaient jusqu’ici transmis oralement furent bientôt notés sur partition et enregistrés, tandis que de plus en plus nombreuses étaient les nouvelles chansons à être composées en style rébétique, ou influencées par lui.
Nous en sommes maintenant revenus au point où nous avions commencé ce chapitre, au Pirée dans les années 1930. Il est un peu arbitraire de faire débuter à cette date ce que l’on peut appeler « l’âge du rébétiko classique », mais elle coïncide avec les premiers enregistrements réalisés par des compagnies comme HMV, Columbia et Odeon. Des hommes comme Yiannis Papaïoannou, Stratos Payiomdzis, Stelios (Stellakis) Perpiniadis, Markos Vamvakaris, Nikos Mathésis, Anestis Delias (Artémis) et Batis allaient bientôt devenir les artistes les plus marquants du nouveau rébétiko, lequel avait déjà une histoire mais pas encore un public très large.
Télécharger le disque au format MP3 (compression .zip): Aux sources du Rébétiko