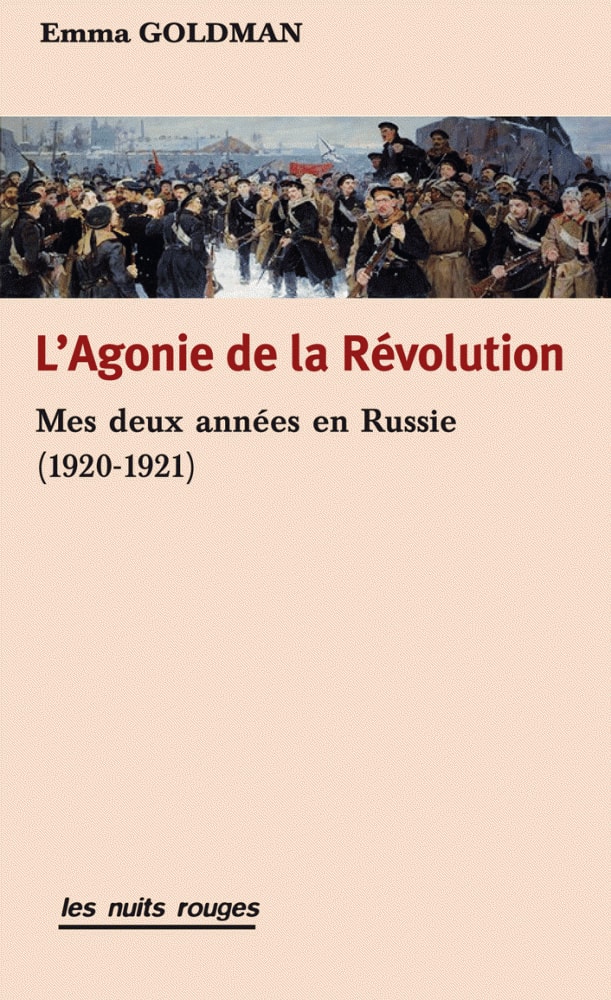L’Agonie de la Révolution
Ce livre contient les récits des rencontres d’Emma Goldman, célèbre anarchiste américaine, avec les dirigeants et militants bolchéviques, ainsi qu’avec les anarchistes persécutés et d’innombrables anonymes rencontrés au cours de ses voyages en Russie soviétique. Elle constate que, deux ans et demi après Octobre, Le système, dont elle analyse la nature, réunit déjà en germe tout ce qui fera le totalitarisme stalinien, à l’exception du culte de la personnalité, dont Lénine ne voulait pas.
Prix : 15.00€
Description
Lire un extrait
Moscou : Premières impressions
Passer de Pétrograd à Moscou, c’est comme être brusquement transporté en ville depuis un désert, tant le contraste est grand. En arrivant sur l’immense place ouverte qui fait face à la gare principale de Moscou, je fus frappée par la vue d’une foule affairée, les taxis et les porteurs. Pendant tout le trajet de la gare au Kremlin, ce fut le même spectacle. Les rues grouillaient d’hommes, de femmes et d’enfants. Presque tous portaient un baluchon, ou tiraient un traîneau chargé. Il y avait de la vie, de l’agitation, du mouvement, c’était très différent du calme oppressant que j’avais ressenti à Pétrograd.
Je remarquai un considérable déploiement de soldats dans la ville et des douzaines d’hommes vêtus de cuir avec des pistolets à la ceinture. « Ce sont les hommes de la Tchéka », expliqua Radek. J’en avais déjà entendu parler : à Pétrograd, elle suscitait terreur et haine. Cependant, soldats et tchékistes n’étaient guère présents dans la ville traversée par la Néva. Ici, à Moscou, on avait l’impression de les voir partout. Leur présence me rappela une remarque de Jack Reed : « Moscou est un camp militaire, disait-il, avec des espions partout, et une bureaucratie des plus autocratiques. Je me sens toujours soulagé quand je quitte Moscou. Pétrograd est une ville prolétarienne, tout imprégnée de l’esprit de la révolution. Moscou a toujours été une ville de hiérarchie. Elle l’est encore plus maintenant. » Je trouvais que Jack Reed avait raison. Moscou a toujours été hiérarchisée. Pourtant la vie y était intense, diverse, passionnante. Ce qui me frappa le plus fortement, à part le déploiement de soldats, ce fut l’attitude préoccupée des gens. On aurait dit qu’ils n’avaient aucun intérêt commun. Chaque individu, détaché de l’ensemble, semblait poursuivre une quête personnelle, poussant, bousculant tous les autres. A plusieurs reprises, je vis des femmes ou des enfants tomber épuisés sans que quiconque ne s’arrête pour leur porter secours. Les gens me regardaient fixement quand je me penchais sur quelque tas de loques abandonnées sur le pavé glissant, ou lorsque je rassemblais les bribes éparpillées d’un baluchon tombé à terre. Je parlai à des amis de ce qui me semblait un étrange manque de solidarité. Ils l’expliquaient comme étant le résultat, d’une part, d’un sentiment de méfiance et de soupçon généralisé, créé par la Tchéka ; et, d’autre part, de la recherche obsessionnelle et quotidienne de nourriture. On n’avait plus assez d’énergie ni de compassion pour penser aux autres. Pourtant il ne semblait pas qu’on manquait autant de nourriture qu’à Pétrograd, et les gens étaient moins froids et un peu mieux habillés.
Je passais beaucoup de temps dans les rues et les marchés. Ces derniers comme le célèbre Soukharova, tournaient à plein. Parfois, les soldats y faisaient des descentes ; mais en général ils étaient tolérés. Ils représentaient la part la plus vivante et la plus intéressante de la vie urbaine. On y rencontrait des prolétaires et des aristocrates, des communistes et des bourgeois, des paysans et des intellectuels. Ils s’y rejoignaient avec le désir commun d’acheter et de vendre, de négocier et de marchander. On y trouvait des vieux pots en fer rouillés à côté de merveilleuses icônes ; une vieille paire de chaussures et de la dentelle des plus délicates ; quelques centimètres de calicot de mauvaise qualité et un beau châle persan ancien. Les riches d’hier, affamés et amaigris, se débarrassant de leurs dernières gloires, et les riches du moment achetant – c’était vraiment une image frappante de la Russie révolutionnaire.
Mais qui achetait les beaux atours d’autrefois, et d’où provenait ce pouvoir d’achat ? Car les acheteurs étaient nombreux. A Moscou, on n’était pas autant privé de sources d’information qu’à Pétrograd ; les rues elles-mêmes alimentaient l’information.
Après quatre années de guerre et trois de révolution, le peuple russe était resté simple. Les gens étaient bien soupçonneux à l’égard des étrangers, et réticents au premier contact, mais quand ils apprenaient qu’on venait d’Amérique et qu’on n’appartenait pas au parti qui gouvernait, ils s’ouvraient petit à petit. J’appris d’eux beaucoup de choses, et j’eus des explications de tout ce qui m’avait troublée depuis mon arrivée. Je parlais fréquemment avec des ouvriers, des paysans, et avec les femmes sur les marchés.
Les forces qui avaient conduit à la Révolution russe, restaient terra incognita pour ces gens simples, mais la révolution les avait touchés au plus profond d’eux-mêmes. Ils n’avaient aucune connaissance théorique, mais ils croyaient que l’ère du barine détesté avait pris fin, et voilà que le barine était de nouveau là, dressé contre eux. « Le barine a tout, disaient-ils, du pain blanc, des vêtements, et même du chocolat, alors que nous, nous n’avons rien. Le communisme, l’égalité, la liberté, pestaient-ils : rien que mensonges et tromperie ! »
Je rentrais au National meurtrie et tourmentée, mes illusions ébranlées, mes certitudes s’évanouissant. Mais je ne cédais pas. Après tout, pensais-je, les gens ne comprenaient pas les énormes difficultés auxquelles le gouvernement était confronté : les forces impérialistes coalisées contre la Russie, les nombreuses agressions qui la privaient des hommes qui autrement auraient accompli un travail productif, le blocus qui frappait impitoyablement les plus jeunes et les plus faibles. Non, bien sûr, les gens ne comprenaient pas tout cela, et je ne devais pas me laisser abuser par leur amertume, née de leur souffrance. Je devais être patiente. Il fallait que je remonte à la source des maux que je constatais.
Le National, comme l’Astoria de Pétrograd, était un ancien hôtel, mais en moins bon état. On n’y donnait pas de rations, sauf trois quarts de livre de pain tous les deux jours. Mais il y avait une salle commune où déjeuners et dîners étaient servis. Les repas consistaient en une soupe, un peu de viande, parfois du poisson ou des crêpes, et du thé. Le soir, nous avions en général de la kacha et du thé. La nourriture n’était pas très abondante, mais on aurait pu s’en accommoder si elle n’avait pas été aussi abominablement mal préparée. Je ne comprenais pas pourquoi on la gâchait ainsi. En visitant la cuisine, je vis une armée de serveurs contrôlés par un grand nombre de responsables, chefs et inspecteurs. Les serveurs étaient mal payés ; qui plus est, ils ne mangeaient pas la même nourriture que nous. Cette discrimination les blessait, et ils ne s’intéressaient pas à leur travail. Il en résultait une vaste corruption et un immense gâchis ; ce qui était criminel, vu le manque général de nourriture. Peu de résidents du National prenaient leurs repas dans la salle commune, m’apprit-on. Ils préparaient, ou faisaient préparer par leurs domestiques, leurs repas dans une cuisine séparée mise à leur disposition pour cela. Tout comme à l’Astoria, je retrouvai les mêmes luttes pour une place sur la cuisinière, les mêmes querelles et les mêmes zizanies, les mêmes regards avides et envieux des uns vers les autres. Etait-ce cela, le communisme en action ? Je me le demandais bien. J’entendais l’explication habituelle : Ioudénitch, Dénikine, Koltchak, le blocus… mais ces réponses stéréotypées ne me satisfaisaient plus.
Avant que je ne quitte Pétrograd, Jack Reed m’avait dit : « Quand tu seras à Moscou, va voir Angelica Balabanova. Elle te recevra avec plaisir et te logera au cas où tu ne trouverais pas de chambre. » J’avais entendu parler d’elle, je connaissais son travail et étais naturellement impatiente de la rencontrer.
Quelques jours après mon arrivée à Moscou, je l’appelai. Voulait-elle me voir ? Oui, tout de suite, bien qu’elle ne se sente pas bien. Je la trouvai dans une petite chambre sans joie, couchée sur le sofa, pelotonnée. Elle n’avait rien d’impressionnant, à part ses grands yeux, lumineux, qui irradiaient la sympathie et la gentillesse. Elle me reçut de la façon la plus gracieuse, comme une vieille amie, et commanda tout de suite l’inévitable samovar. En buvant ce thé, nous parlâmes de l’Amérique, de son mouvement ouvrier, de notre expulsion et enfin de la Russie. Je réitérai les questions que j’avais posées à beaucoup de communistes, au sujet des contrastes et des oppositions auxquels j’étais confrontée à chaque pas. Elle me surprit en ne reprenant pas les justifications habituelles ; c’était la première personne qui ne me servait pas le refrain rituel. Elle évoqua bien le manque de nourriture, de combustible, de vêtements, qui était cause des pots-de-vin et de corruption ; mais dans l’ensemble, elle trouvait la vie mesquine et limitée. « Elle est comme un récif, les espoirs les plus élevés s’y brisent ; elle contrecarre les meilleures intentions et casse les plus belles ardeurs », dit-elle. C’était une manière de voir plutôt inhabituelle pour une marxiste, une communiste, une de celles qui étaient au cœur de la bataille. Je savais qu’elle était secrétaire de la IIIe Internationale à ce moment-là. Et voilà que j’avais affaire à une forte personnalité, ce n’était pas la voix de son maître, mais quelqu’une qui sentait la complexité de la situation en Russie. Je la quittai profondément impressionnée, et séduite par ses yeux tristes et brillants.
Je découvris vite que Balabanova – ou Balabanoff, comme elle préférait qu’on l’appelle – répondait aux moindres désirs de chacun. Bien que de santé fragile, et quoique occupant de nombreuses fonctions, elle trouvait pourtant le temps de satisfaire les demandes de ses très nombreux solliciteurs. Souvent, elle ne disposait pas elle-même du nécessaire, donnant ses propres rations, toujours occupée à rechercher un médicament ou quelque petite friandise pour un malade ou une personne souffrante. Elle se souciait principalement des Italiens abandonnés, dont un certain nombre se trouvaient à Pétrograd et à Moscou. Elle avait vécu et travaillé en Italie pendant de nombreuses années, tant et si bien qu’elle était quasiment devenue Italienne elle-même. Elle se sentait profondément proche d’eux, qui se sentaient aussi éloignés des événements de Russie que de leur sol natal. Elle était leur amie, leur conseillère, leur soutien principal dans un monde de conflits et de luttes. Cette remarquable petite femme ne se souciait pas que des Italiens, mais de presque tous les autres : nul besoin de carte du Parti pour entrer dans son cœur. Rien d’étonnant à ce que certains de ses camarades la considérassent comme « une sentimentale qui perdait un temps précieux à faire de la philanthropie ». J’eus beaucoup de joutes verbales sur ce thème avec ce genre de communistes devenus durs et insensibles, entièrement dépourvus des qualités qui caractérisaient les idéalistes russes d’autrefois.
J’avais entendu les mêmes critiques au sujet d’un autre responsable communiste, Lounatcharski. Déjà à Pétrograd, on m’avait dit, sur un ton méprisant : «Lounatcharski est un écervelé qui gaspille des millions sur des projets insensés. » Mais j’avais grande envie de rencontrer l’homme qui était commissaire d’un des plus importants départements du gouvernement, celui de l’Instruction publique. Et justement une chance de le voir se présenta.
Je trouvai le Kremlin, la vieille citadelle du tsarisme, lourdement gardée et inaccessible au « commun des mortels ». Mais j’étais venue sur rendez-vous et en compagnie d’un homme qui avait une carte d’accès, ce qui me permit de passer les contrôles sans difficulté. Nous arrivâmes bientôt aux appartements de Lounatcharski, situés dans un étrange vieux bâtiment à l’intérieur de l’enceinte. Bien que la salle d’attente fût remplie de gens attendant d’être reçus, Lounatcharski me fit appeler dès que je fus annoncée.
Son accueil fut très cordial. Est-ce que je voulais « rester un électron libre » ou bien le rejoindre dans son travail ? Ce fut une de ses premières questions. J’étais plutôt surprise. Pourquoi fallait-il renoncer à sa liberté, particulièrement dans l’éducation ? L’initiative et la liberté n’étaient-elles pas essentielles ? Mais j’étais venue pour apprendre de Lounatcharski ce qu’il fallait savoir du système éducatif révolutionnaire, dont nous avions tant entendu parler en Amérique. Je m’intéressais tout spécialement aux soins qu’on donnait aux enfants. Les colonnes de la Pravda de Moscou, comme celles des journaux de Pétrograd, était remplies de la controverse au sujet du traitement des déficients moraux. J’exprimai ma surprise devant l’attitude de la Russie soviétique. « Bien sûr, tout ça est barbare et rétrograde, et je le combats bec et ongles, m’assura Lounatcharski. Les défenseurs de la prison pour les enfants sont de vieux juristes spécialisés dans les affaires pénales, toujours marqués par les méthodes tsaristes. J’ai mis sur pied une commission de médecins, de pédagogues et de psychologues pour traiter de ce problème. Bien sûr, ces enfants ne doivent pas être punis… »
Je me sentis extrêmement soulagée. Enfin, un homme qui s’était éloigné des vieilles et cruelles méthodes ! Je lui parlai de l’excellent travail accompli dans l’Amérique capitaliste par le juge Lindsay, et de quelques écoles expérimentales pour enfants attardés. Lounatcharski était très intéressé. « Oui, c’est exactement ce que nous voulons faire, le système éducatif américain », s’exclama-t-il. « Vous ne voulez sûrement pas parler du système éducatif public ? lui demandai-je, vous connaissez sans doute le mouvement américain contre les méthodes éducatives de nos écoles publiques, le travail de Dewey et autres ? » Lounatcharski en avait très peu entendu parler. La Russie avait été si longtemps coupée du monde occidental, et il y avait un grand manque d’ouvrages sur l’éducation moderne. Mais il avait très envie de connaître les idées et méthodes nouvelles. Je sentis en lui une personnalité qui était pleine de confiance et de dévouement à la révolution, quelqu’un qui poursuivait un grand travail sur l’éducation dans un environnement difficile, matériellement et moralement.
Il suggéra qu’on convoque la tenue d’une conférence de professeurs, que je pourrai entretenir des tendances nouvelles du système éducatif américain, ce que j’acceptai immédiatement. Les écoles et autres établissements dépendant de lui, nous les visiterions plus tard. Je le quittai pleine d’un nouvel espoir. J’allais le seconder dans son travail, me réjouissais-je. Quel service plus important que celui-là pouvais-je rendre au peuple russe ?
Pendant mon séjour à Moscou, je vis Lounatcharski plusieurs fois. Il fut toujours le même, agréable et gentil, mais je me rendis vite compte qu’il était freiné dans son élan par des forces qui œuvraient à l’intérieur de son propre camp : la plupart de ses bonnes intentions et décisions ne voyaient jamais le jour. De toute évidence, il était prisonnier de la même machine qui paraissait tout tenir dans une main de fer. Mais quelle était cette machine ? Et qui la conduisait ?
Bien que le contrôle des visiteurs au National fût très strict – personne ne pouvant entrer ni sortir sans un laissez-passer spécial (propousk) –, des hommes et des femmes de différents groupes politiques se débrouillèrent pour venir me voir. Des anarchistes, des socialistes-révolutionnaires de gauche, des membres de coopératives, et des gens que j’avais connus en Amérique, rentrés en Russie pour prendre leur part dans la révolution. Ceux-là étaient venus pleins de confiance et d’espoir, mais je les trouvai presque tous découragés, et même, pour certains, amers. Malgré le large éventail de leurs positions politiques, presque tous mes visiteurs racontaient une histoire similaire, celle du raz-de-marée révolutionnaire, de l’extraordinaire esprit qui avait poussé le peuple en avant, des capacités des masses, du rôle des bolchéviques en tant que promoteurs des mots d’ordre révolutionnaires les plus extrêmes, et de leur trahison de la révolution après qu’ils se furent assurés du pouvoir. Tous disaient que la paix de Brest-Litovsk avait été le début de la descente aux enfers. Les socialistes-révolutionnaires de gauche surtout, individus cultivés et sérieux, qui avaient beaucoup souffert sous le tsar, et voyaient désormais leurs espoirs et leurs aspirations mis en échec, étaient les plus virulents. Leurs déclarations étaient étayées par les preuves des ravages causés par les réquisitions forcées et les expéditions punitives dans les villages, de l’abîme créé entre villes et campagnes, de la haine générée entre paysans et ouvriers. Ils parlaient des persécutions subies par leurs camarades, de femmes et d’hommes innocents fusillés, de la criminelle inefficacité du système, du gaspillage et des destructions.
Comment, dès lors, les bolchéviques pouvaient-ils se maintenir au pouvoir ? Après tout, ils n’étaient qu’une petite minorité, environ cinq cent mille, estimation haute. Les masses, me disait-on, étaient épuisées, car affamées, et domptées par la terreur. En outre, elles avaient perdu toute confiance dans les idées et les partis. Cependant, il y avait de fréquents soulèvements, çà et là, brutalement réprimés. Il y avait aussi constamment des grèves à Moscou, à Pétrograd et dans d’autres centres industriels, mais la censure était si implacable que les masses, en général, en étaient très peu informées.
J’interrogeai mes visiteurs sur l’intervention étrangère. « Nous ne voulons d’aucune ingérence extérieure » fut la réponse unanime. Ils soutenaient que les ingérences ne faisaient que renforcer le pouvoir des bolchéviques. De ce fait, ils ne pouvaient pas s’en prendre à eux publiquement tant que la Russie était attaquée, et encore moins au régime. « Est-ce que leurs méthodes ne sont pas dictées par l’intervention et le blocus? » demandai-je. « En partie seulement, me répondaient-ils. La plupart de leurs procédés proviennent de leur méconnaissance du caractère et des besoins du peuple russe, et de leur folle obsession de la dictature, qui n’est même pas la dictature du prolétariat, mais la dictature d’un petit groupe sur le prolétariat. »
Quand j’abordai la question des soviets et des élections, mes visiteurs s’esclaffèrent : « Des élections ! ça n’existe pas en Russie, sauf si vous appelez “élections” ce qui n’est que menaces et terreur. Ce n’est que comme ça que les bolchéviques obtiennent une majorité. Quelques menchéviques, des socialistes-révolutionnaires ou des anarchistes, ont le droit de se glisser dans les soviets, mais ils n’ont pas l’ombre d’une chance d’être entendus. »
Le tableau paraissait noir et lugubre. Mais je m’accrochai à mon principe de confiance.